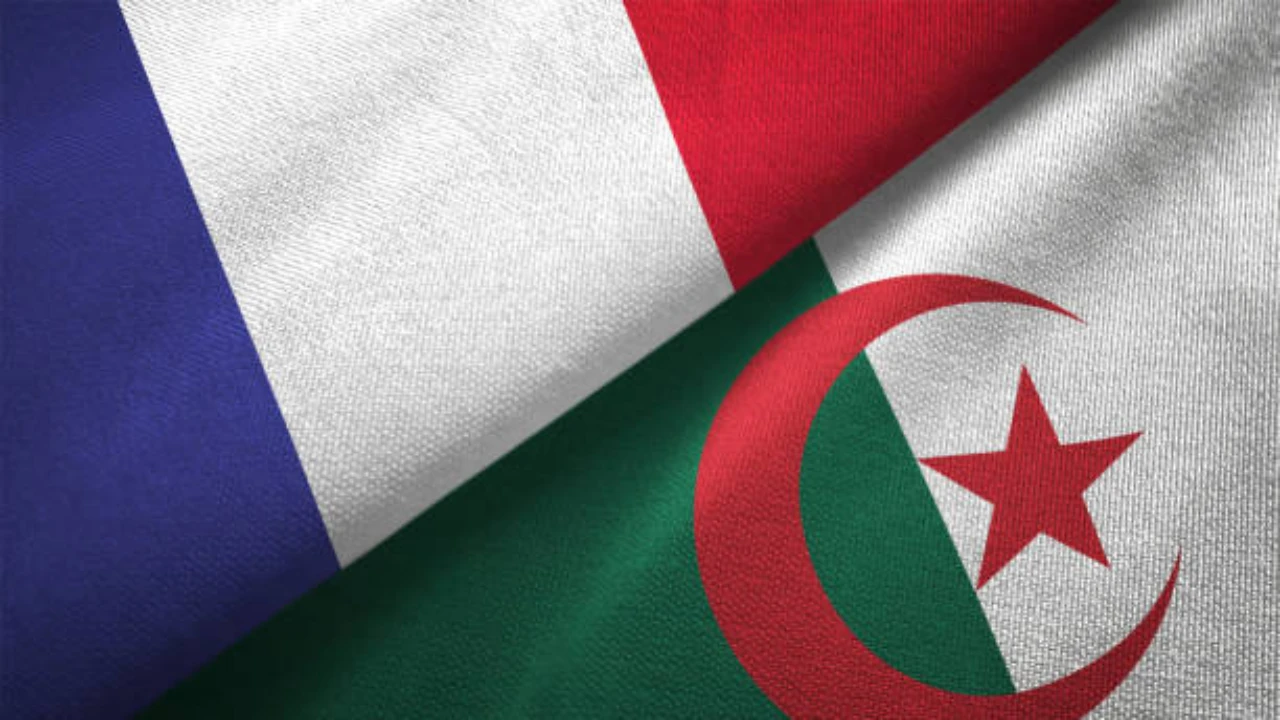Plus de cinquante ans après sa signature, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 suscite encore débats, controverses et manipulations politiques. Cet accord franco-algérien, né dans le sillage des accords d’Évian, devait symboliser la continuité d’un lien humain et économique entre deux peuples autrefois unis par l’histoire coloniale. Mais l’accord franco-algérien, autrefois perçu comme un pont, est aujourd’hui vidé de sa substance, transformé en un simple outil administratif, loin de sa vocation initiale. Présenté en France comme un « privilège » dont bénéficieraient encore les Algériens, il n’en est plus qu’une coquille juridique creuse, souvent utilisée comme argument politique ou diplomatique.
En décembre 1968, la France et l’Algérie cherchaient à stabiliser leurs relations après des années de tensions post-indépendance. Ce texte bilatéral, signé à Paris, visait à encadrer la circulation, le travail et le séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Dans un contexte où des milliers d’Algériens participaient déjà à la reconstruction économique de la France, l’accord était censé garantir un traitement équitable et une continuité humaine entre les deux rives. Pourtant, les décennies suivantes ont transformé cette promesse en un ensemble de contraintes. Dès 1974, la suspension de l’immigration de travail marque un tournant majeur : la France, confrontée à la crise économique, ferme ses portes, trahissant l’esprit d’ouverture qui avait présidé à la signature du texte.
Les années 1980 renforcent cette rupture. En 1986, la mise en place du visa obligatoire pour les Algériens incarne le basculement d’une logique de coopération vers une logique de contrôle. Puis, en 1993, la loi Pasqua durcit davantage les conditions d’entrée et de séjour, réduisant les marges d’application du texte de 1968. Chaque révision, chaque circulaire, chaque décision administrative a progressivement vidé l’accord de sa substance. Ce qui devait être un instrument d’amitié est devenu une entrave bureaucratique.
Aujourd’hui, la réalité est limpide : l’accord n’offre plus d’avantages réels aux Algériens. Au contraire, il maintient une différence de traitement souvent défavorable. Les procédures sont plus longues, les justificatifs plus nombreux, les refus plus fréquents. Pourtant, paradoxalement, cet accord est encore agité dans le débat politique français comme une anomalie juridique qu’il faudrait corriger. Certains responsables affirment qu’il confère un « régime de faveur » aux Algériens, alors qu’il ne subsiste que des contraintes. Derrière cette affirmation, se cache une instrumentalisation politique, où les mots pèsent plus que les faits. L’accord devient un bouc émissaire commode, évoqué chaque fois que le climat politique s’échauffe autour de la question migratoire.
Les étudiants algériens, eux, en paient le prix le plus fort. Leur parcours administratif en France illustre à quel point les dispositions du texte sont dépassées. Dès la demande de visa, les obstacles sont innombrables : dossiers rejetés sans explication, rendez-vous rares dans les centres de dépôt, exigences financières démesurées. Beaucoup se heurtent à des refus sans justification, malgré des projets d’études solides. Et une fois arrivés en France, le parcours ne devient pas plus simple. Là où la plupart des étudiants étrangers peuvent travailler librement dans la limite de 964 heures annuelles, les étudiants algériens doivent obtenir une autorisation préalable. Leur statut demeure encadré par un texte vieux de plus d’un demi-siècle, qui n’a jamais été adapté aux réalités contemporaines.
Cette différence s’étend jusqu’à la fin de leurs études. Alors que la majorité des diplômés étrangers peuvent bénéficier d’une Autorisation Provisoire de Séjour pour chercher un emploi, les étudiants algériens, eux, n’y ont pas droit. Ils doivent soit trouver un employeur immédiatement, soit quitter le territoire. Même lorsqu’un poste leur est proposé, la rémunération exigée pour un changement de statut – 1,5 fois le SMIC – rend cette transition presque impossible. Cette situation pousse de nombreux diplômés à rentrer en Algérie, parfois à contrecœur, laissant derrière eux des opportunités manquées. D’autres basculent dans la précarité, travaillant dans des conditions informelles, en marge du système.
Derrière ces parcours individuels se joue une réalité politique plus large. La France, en durcissant sa politique des visas et en limitant les bénéfices de l’accord, utilise la question migratoire comme levier diplomatique. Chaque tension bilatérale se traduit par une restriction administrative. L’octroi des visas devient un instrument de pression, conditionné à des coopérations dans d’autres domaines : sécurité, expulsions, commerce. Dans cette relation, l’égalité proclamée dans le texte originel semble n’être qu’un souvenir.
Pourtant, les chiffres sont clairs : les Algériens ne représentent plus qu’une fraction des flux migratoires vers la France, loin derrière d’autres nationalités. Le discours sur un prétendu « privilège » est donc infondé. Il persiste néanmoins dans l’imaginaire collectif, alimenté par des polémiques politiques et des campagnes médiatiques récurrentes. L’accord franco-algérien est devenu un symbole commode, évoqué pour flatter certains électorats ou détourner l’attention des véritables enjeux socio-économiques.
Du côté algérien, la lassitude grandit. Les autorités dénoncent régulièrement une approche unilatérale de la part de Paris, où chaque modification ou restriction semble imposée sans concertation réelle. L’esprit de partenariat qui devait guider la relation s’est effrité. De nombreux observateurs considèrent que l’accord, dans sa forme actuelle, ne correspond plus aux besoins ni aux réalités des deux peuples. Il sert davantage à maintenir un cadre administratif obsolète qu’à encourager la mobilité ou la coopération.
Mais rompre cet accord n’est pas une solution simple. Il constitue encore la base juridique de la présence de centaines de milliers d’Algériens en France. Le modifier nécessite un dialogue bilatéral sincère, loin des calculs politiques. Il s’agit de repenser les conditions de mobilité, de travail et d’études, dans un esprit d’équité et de respect mutuel. Car un accord, aussi ancien soit-il, ne doit pas devenir une arme politique. Il doit rester un instrument au service des peuples.
Aujourd’hui, alors que la France et l’Algérie prétendent vouloir renforcer leur coopération, il serait temps de regarder en face ce qu’est devenu ce texte. L’accord franco-algérien, conçu pour unir, divise désormais. Il devait rapprocher deux nations, il symbolise leur incompréhension. Il devait faciliter les échanges, il complique les vies.
Un demi-siècle plus tard, le constat est amer : ce qui fut une promesse d’ouverture n’est plus qu’un vestige juridique. Un document qu’on invoque sans le comprendre, qu’on brandit sans le lire. Pour beaucoup d’Algériens, il incarne la frustration d’une génération qui croyait encore au dialogue. Pour d’autres, il représente la preuve que la France n’a jamais réellement voulu d’une égalité de traitement.
L’accord de 1968 restera dans l’histoire comme le témoin d’une époque où l’espoir d’un lien durable entre les deux pays semblait possible. Mais aujourd’hui, ce qu’il en reste, c’est une coquille vide, un symbole figé d’une relation qui, faute d’être repensée, continue de s’éroder sous le poids des malentendus, des calculs et du temps.