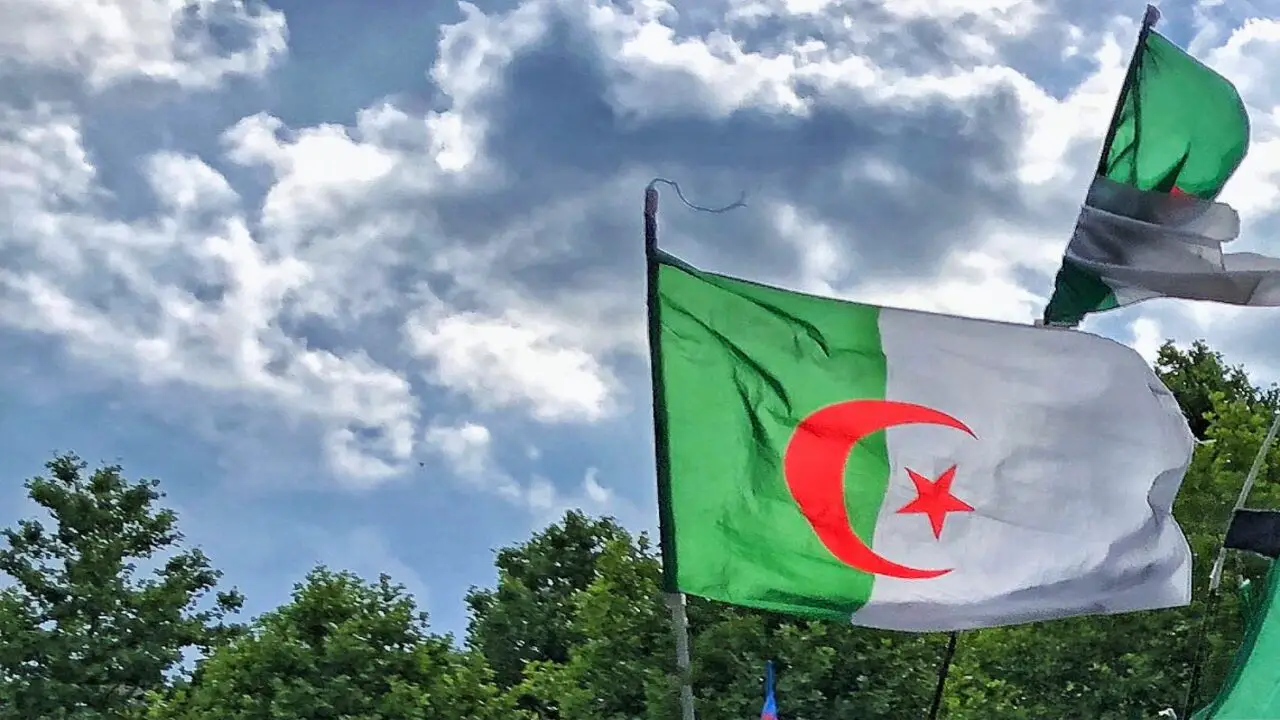Ahmed Taleb Ibrahimi est décédé ce dimanche à l’âge de 93 ans, emportant avec lui une partie de la mémoire vivante de l’Algérie indépendante. Le nom d’Ahmed Taleb Ibrahimi, intimement lié à l’histoire politique, culturelle et diplomatique du pays, restera associé à l’engagement, à la rigueur intellectuelle et à la fidélité à une certaine idée de l’Algérie. Figure respectée autant pour son parcours que pour la constance de ses convictions, Ahmed Taleb Ibrahimi laisse derrière lui un héritage dense, construit à travers plusieurs décennies de service public, de réflexion et d’écriture.
Né le 5 janvier 1932 à Sétif, Ahmed Taleb Ibrahimi grandit dans un environnement marqué par la foi, la science et la culture. Son père, Mohamed Bachir El Ibrahimi, est une figure emblématique du réformisme musulman, cofondateur de l’Association des oulémas musulmans algériens, et un acteur majeur du renouveau intellectuel du Maghreb au XXᵉ siècle. Héritier de cette tradition, Ahmed Taleb Ibrahimi s’oriente très tôt vers les études médicales, obtenant son doctorat en médecine tout en restant profondément engagé dans la cause nationale. Pendant la guerre de libération, il rejoint les rangs du mouvement indépendantiste à travers l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), qu’il contribue à structurer et à animer dans des conditions extrêmement difficiles. Son militantisme lui vaut plusieurs arrestations, mais n’entame jamais sa détermination. Pour lui, la médecine, la science et la politique étaient trois voies complémentaires pour servir son pays et son peuple.
Après l’indépendance en 1962, Ahmed Taleb Ibrahimi entame une carrière publique qui marquera durablement les institutions de l’État algérien. Il devient ministre de l’Éducation nationale dès 1965 sous la présidence de Houari Boumédiène. À ce poste, il œuvre pour la généralisation de l’enseignement et la valorisation de la langue arabe, tout en posant les bases d’un système éducatif national moderne. Son passage à la tête du ministère est souvent cité comme une période de structuration et de réforme en profondeur, malgré les défis liés à la jeunesse de l’État et au manque de cadres formés.
En 1970, Ahmed Taleb Ibrahimi est nommé ministre de l’Information et de la Culture, fonction stratégique à une époque où l’Algérie cherche à affirmer son identité culturelle et politique sur la scène internationale. C’est sous son impulsion que plusieurs initiatives voient le jour pour renforcer la souveraineté médiatique et valoriser la production culturelle nationale. Son sens du dialogue et son respect du pluralisme intellectuel lui valent la reconnaissance de nombreux artistes et journalistes.
En 1982, sous la présidence de Chadli Bendjedid, Ahmed Taleb Ibrahimi accède au poste de ministre des Affaires étrangères. C’est une période charnière dans sa carrière. À la tête de la diplomatie algérienne, il consolide l’image du pays comme acteur central du mouvement des non-alignés et défenseur du dialogue entre le Nord et le Sud. Dans les conférences internationales comme à l’ONU, Ahmed Taleb Ibrahimi plaide pour un monde plus juste, où les nations du Sud peuvent faire entendre leur voix sans dépendance ni complexe. Sa vision de la politique étrangère repose sur la souveraineté, la solidarité africaine et la fidélité aux principes de la révolution algérienne.
À la fin des années 1980, après avoir quitté le gouvernement, Ahmed Taleb Ibrahimi prend du recul et se consacre à la réflexion politique. Il continue d’écrire, d’analyser et de proposer des pistes pour une Algérie plus équilibrée, plus démocratique et plus fidèle à ses valeurs fondatrices. En 1999, il tente un retour dans la vie publique en se présentant à l’élection présidentielle, avant de se retirer face à l’évolution du paysage politique. Malgré cela, sa parole continue d’avoir du poids, notamment dans les milieux intellectuels et universitaires, où il reste une référence en matière d’éthique et de patriotisme.
Tout au long de sa vie, Ahmed Taleb Ibrahimi a publié plusieurs ouvrages mêlant mémoire, réflexion et témoignage. Ses écrits, nourris d’expérience et de rigueur historique, constituent une contribution précieuse à la compréhension du destin algérien contemporain. Dans ses livres, il revient avec lucidité sur les espoirs et les désillusions de l’indépendance, sur les défis de la construction nationale, et sur la nécessité de concilier modernité et authenticité. Il y aborde aussi son propre parcours, sans complaisance ni amertume, dans un style clair et sobre, fidèle à son tempérament.