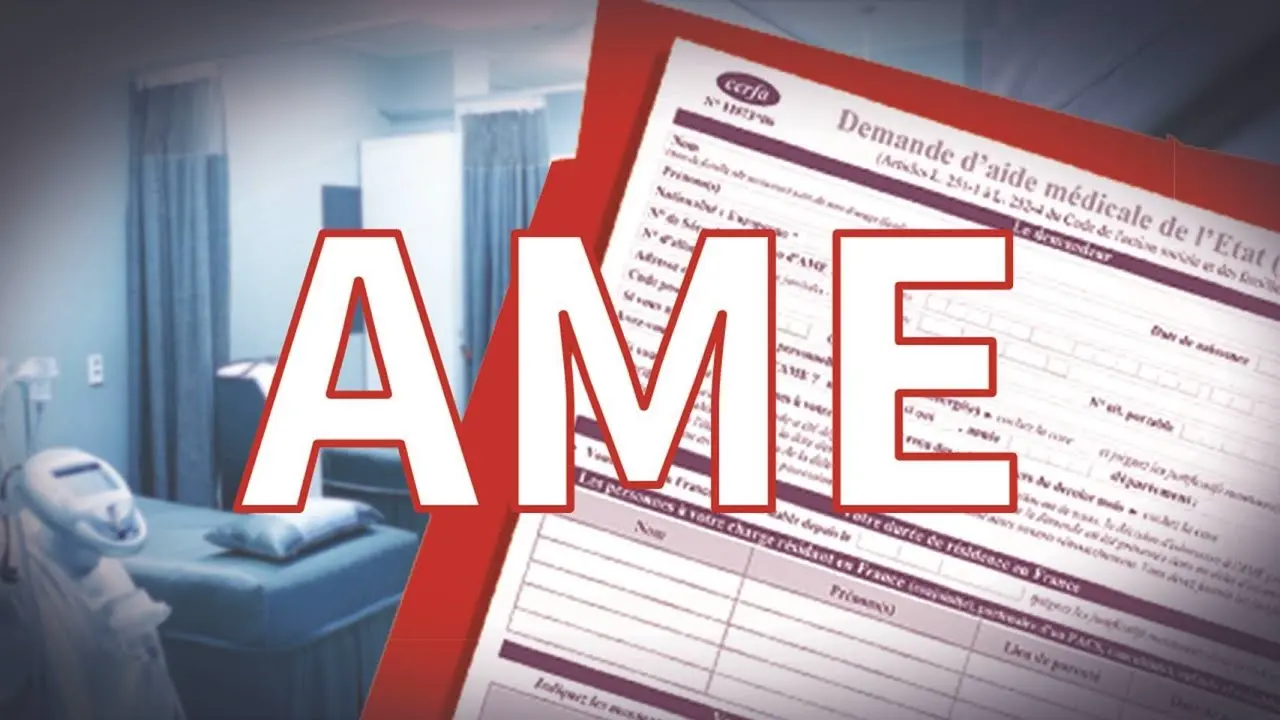Depuis plusieurs années, l’Aide médicale d’État (AME) est au cœur de vifs débats en France, entre polémiques politiques et dénonciations médiatiques. Récemment, une enquête publiée par l’hebdomadaire Marianne a mis en lumière des dérives inattendues de ce dispositif censé garantir l’accès aux soins pour les personnes en situation irrégulière. Pourtant, et fait rare dans ce type d’affaires, les Algériens ne semblent pas concernés par ces abus, eux qui sont souvent pointés du doigt, notamment par le ministre de l’intérieur français Bruno Retailleau, lorsqu’il est question de dispositifs sociaux en France.
L’AME, instaurée en 2000, avait pour vocation initiale de couvrir les frais de santé de personnes sans-papiers vivant sur le territoire français, dans une démarche humanitaire et sanitaire. Selon l’enquête menée par la journaliste Rachel Binhas, cette mission s’est peu à peu transformée. Initialement restreint aux maladies mettant en péril le pronostic vital, comme le VIH et le Sida qui touchaient notamment des ressortissants subsahariens, le dispositif a vu son champ d’application progressivement élargi. Cette extension, soutenue par certaines décisions de justice administrative, a conduit à des situations où l’absence d’accès aux soins dans le pays d’origine suffit désormais à justifier une admission au bénéfice de l’AME.
La journaliste Rachel Binhas, invitée sur le plateau des Grandes Gueules, a ainsi détaillé comment une lecture extensive du dispositif, combinée à une méconnaissance de son cadre légal par certains soignants, a conduit à des dérives spectaculaires. Elle cite notamment l’exemple d’une ressortissante djiboutienne ayant été autorisée à venir en France pour y réaliser une quatrième tentative de procréation médicalement assistée (PMA), alors même que ce type d’intervention est extrêmement coûteux dans son pays d’origine.
L’enquête met également en évidence que des ressortissants d’États non européens comme les États-Unis et le Japon, où les soins médicaux sont parmi les plus chers du monde, saisissent eux aussi l’opportunité de se faire soigner en France via l’AME. À travers des démarches parfois facilitées par les recours judiciaires, ces personnes obtiennent le droit de venir bénéficier gratuitement de traitements coûteux, financés par le contribuable français. Une situation qui soulève des interrogations légitimes sur la soutenabilité financière du dispositif.
Le mécanisme est simple : une personne étrangère effectue une demande de « titre étranger malade ». Cette demande est ensuite examinée par un médecin de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration), dont l’avis peut être soit favorable, soit défavorable. Si l’avis est négatif, le demandeur peut alors engager un recours devant le juge administratif, voire jusqu’au Conseil d’État. Dans de nombreux cas, contre l’avis médical initial, les magistrats autorisent finalement l’entrée du demandeur sur le territoire national pour recevoir des soins.
Ce recours massif à la justice pour contourner les avis médicaux soulève de nombreuses critiques. D’autant plus que le coût de l’AME n’a cessé d’augmenter : passant de 80 000 bénéficiaires en 2000 à 440 000 aujourd’hui, pour une dépense annuelle atteignant 1,2 milliard d’euros. Des chiffres qui alimentent les débats sur la pertinence et l’efficacité du dispositif dans son état actuel.
Cependant, dans cette avalanche de critiques et de révélations troublantes, un point mérite d’être souligné : les ressortissants algériens ne sont pas cités parmi les auteurs de ces abus. Un constat d’autant plus remarquable que, dans le climat politique français, les Algériens sont souvent accusés, à tort ou à raison, d’abuser des prestations sociales. Pour une fois, ils échappent donc à la stigmatisation et aux accusations pesant sur d’autres nationalités concernant l’usage inapproprié de l’AME.
Cette distinction dans l’enquête de Marianne vient rappeler que l’exploitation abusive des dispositifs sociaux n’est pas l’apanage d’une seule communauté ou d’une seule origine. Elle illustre aussi la complexité de maintenir des mécanismes de solidarité en équilibre entre nécessité humanitaire et impératif budgétaire. Si la question de la réforme de l’AME revient régulièrement dans le débat public, à l’instar de la récente proposition de Michel Barnier visant à en réduire le champ d’application, il semble essentiel d’aborder ce sujet avec nuance et rigueur, loin des amalgames et des généralisations hâtives.
Dans ce contexte tendu où les questions migratoires, sanitaires et économiques s’entrelacent, la situation des Algériens apparaît ici comme une exception notable, offrant un contre-exemple aux critiques systématiques souvent formulées à leur encontre dans l’Hexagone.