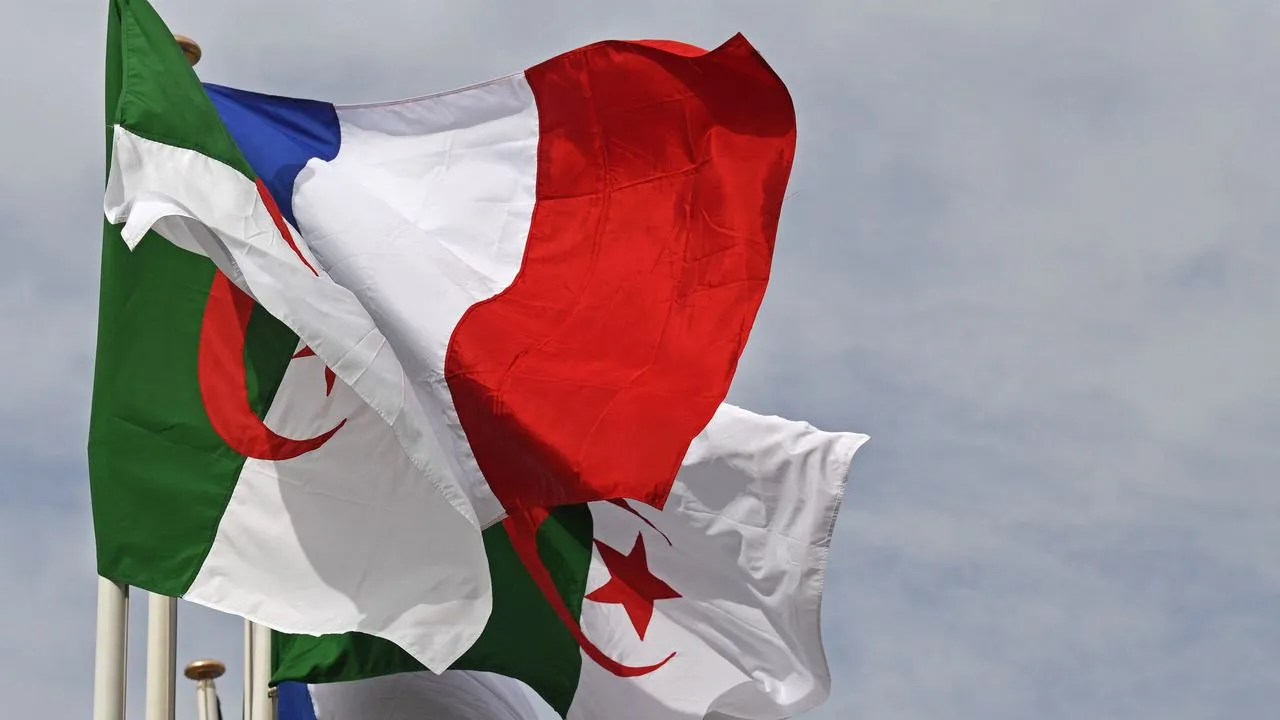Alors que la France revendique avec force l’indépendance de sa justice et le respect du principe de séparation des pouvoirs, elle ne semble pas appliquer cette rigueur avec la même constance lorsqu’il s’agit de l’Algérie. La récente affaire du Franco-Algérien Boualem Sansal en est une illustration frappante. Ce dernier a été condamné par la justice algérienne à cinq ans de prison ferme en raison de ses déclarations médiatiques, de certaines vidéos et correspondances jugées répréhensibles par les autorités judiciaires du pays.
Cette condamnation, survenue après une enquête ouverte en novembre dernier, a rapidement suscité l’indignation en France, où les médias et les acteurs politiques ont multiplié les appels à sa libération. Pourtant, des cas similaires dans l’Hexagone ne bénéficient pas du même traitement médiatique, en particulier lorsque cela concerne des opposants ou des militants évoluant dans les territoires d’outre-mer.
L’affaire Sansal met en lumière une approche sélective et contrastée du droit international par la France. Elle fait écho à d’autres dossiers, notamment celui d’Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie en Algérie, dont l’extradition a été refusée par la France malgré l’accord de coopération judiciaire signé entre les deux pays en 2019. La question de l’application équitable des principes juridiques se pose également dans le cas de Rachid Nekkaz, militant politique franco-algérien, qui a dénoncé l’absence totale de mobilisation des milieux politiques, médiatiques et intellectuels français lorsqu’il a été emprisonné en Algérie. « J’ai pourtant la nationalité française depuis quarante ans », a-t-il déclaré dans un entretien avec Radio Sud, s’étonnant du silence entourant son cas, alors que l’affaire Sansal a fait la une des médias. Ce dernier, naturalisé français il y a seulement un an, bénéficie d’un élan de soutien que Nekkaz n’a jamais connu.
Dans ses déclarations, Nekkaz a également souligné l’ambiguïté du positionnement français à son égard. Bien qu’ayant été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, il s’est vu condamné par la justice française à 18 mois de prison ferme, avec un gel de ses comptes bancaires et de ses biens. Selon lui, cela démontre que l’Algérie adopte une approche plus pragmatique et diplomatique, évitant de systématiser une logique répressive qui pourrait être perçue comme un acharnement. Concernant Sansal, il estime que les autorités algériennes ne devraient pas appliquer une ligne dure et pourraient privilégier une issue négociée.
Ce paradoxe ne s’arrête pas au domaine judiciaire, il s’étend également à la question du statut administratif de Nekkaz en France. Malgré sa longue nationalité française et ses investissements immobiliers conséquents, il ne bénéficie que d’un titre de séjour de trois mois, un traitement qui contraste fortement avec la facilité qu’il rencontre aux États-Unis pour régulariser sa situation. Cette différence d’attitude illustre bien les contradictions dans la gestion des Franco-Algériens selon les circonstances et les profils.
La couverture médiatique en France reflète également cette approche biaisée. Lorsqu’il s’agit de Sansal, d’Algérie ou de Franco-Algériens impliqués dans des affaires sensibles, les médias appliquent une ligne éditoriale quasi uniforme. Les débats télévisés adoptent des angles similaires, les questions posées aux invités sont souvent orientées, et les analyses tendent à ne pas nuancer les faits, contribuant ainsi à une perception tronquée des réalités judiciaires algériennes. Cette manière de traiter l’information renforce l’idée d’un parti pris flagrant qui vise à polariser l’opinion publique.
D’un point de vue strictement juridique, l’intervention d’Emmanuel Macron et de plusieurs figures politiques françaises pour réclamer la libération de Sansal soulève des interrogations. En effet, sa condamnation n’est pas encore définitive. Le délai légal pour interjeter appel n’expire que jeudi prochain, ce qui signifie que l’affaire peut encore évoluer devant la justice algérienne. Si un appel est déposé, que ce soit par la défense de Sansal ou par le procureur qui avait initialement requis dix ans de prison, toute hypothèse d’une grâce présidentielle ou d’une intervention diplomatique serait immédiatement écartée. La France, qui met en avant son attachement au respect des processus judiciaires, devrait en toute logique reconnaître que l’Algérie dispose elle aussi d’une souveraineté judiciaire qu’elle applique selon ses propres lois et procédures.
Ce traitement différencié pose ainsi une question de fond : pourquoi la justice d’un pays souverain serait-elle systématiquement remise en cause lorsqu’il s’agit de l’Algérie, alors même que des affaires similaires en France ne suscitent ni émoi ni ingérence politique étrangère ? L’Algérie, en tant qu’État indépendant, applique ses lois comme tout autre pays. Si la France souhaite défendre un principe d’indépendance judiciaire, elle devrait veiller à l’appliquer de manière équitable, sans céder à une diplomatie à géométrie variable qui risque d’entacher la crédibilité de son discours sur la séparation des pouvoirs.
Lire également :
Boualem Sansal : la Grande Mosquée de Paris intervient et lance un appel à Tebboune
Algériens, Paris : c’est acté, les amendes vont devenir plus salées
Bagages, Air Algérie : les passagers reçoivent une mise en garde