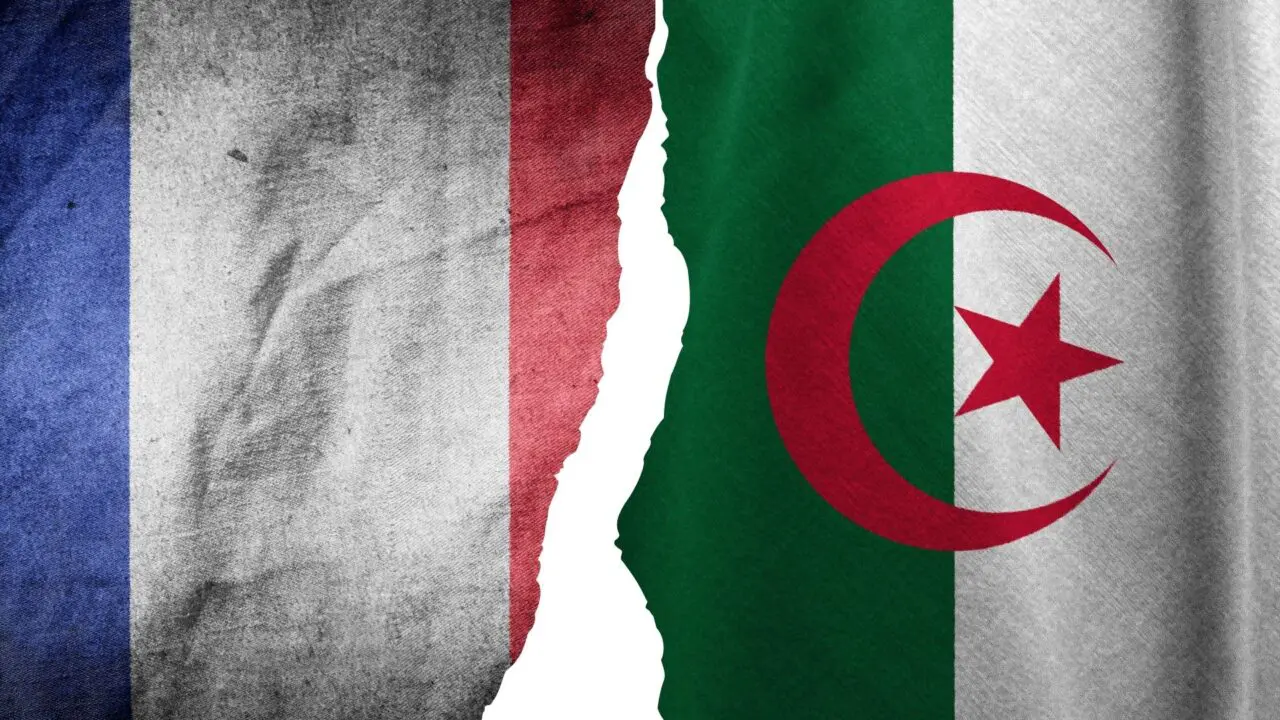Dans un contexte tendu marqué par la crise diplomatique persistante avec l’Algérie, la France a récemment pris une décision qui interpelle autant par ses conséquences économiques que par son impact environnemental. En privilégiant désormais le gaz naturel liquéfié (GNL) américain au détriment du gaz algérien, Paris opère une réorientation énergétique qui soulève de nombreuses interrogations. Cette décision n’est pas anodine : elle affecte les relations historiques entre la France et l’Algérie, elle entraîne un surcoût considérable pour les consommateurs français et elle accentue l’empreinte carbone du pays.
Les chiffres récents illustrent la rupture. En janvier 2025, la France n’a importé que 0,098 million de tonnes de GNL algérien, contre 0,373 million en décembre 2024. Cette chute spectaculaire de 73,7 % en un seul mois témoigne d’un choix stratégique clair. En 2024, l’Algérie était pourtant le deuxième fournisseur de GNL de la France, avec 3,26 millions de tonnes importées, un volume qui confirmait la solidité d’une relation énergétique ancienne malgré les aléas diplomatiques. La décision française bouleverse donc un équilibre qui avait longtemps profité aux deux pays.
L’Algérie représentait un partenaire fiable, à la fois par sa proximité géographique et par ses capacités de production. La France et l’Algérie bénéficiaient d’une distance maritime réduite, environ 800 kilomètres entre Alger et Marseille, contre plus de 7 000 kilomètres pour les États-Unis. Cette proximité se traduisait par des coûts de transport moindres et une empreinte carbone réduite. Les terminaux méthaniers français, comme Fos Cavaou, Montoir-de-Bretagne ou Dunkerque, étaient déjà adaptés pour accueillir le GNL algérien, fruit de décennies de coopération énergétique. De plus, l’Algérie, deuxième fournisseur de gaz par pipeline à l’Union européenne avec 30,75 milliards de mètres cubes en 2024, garantissait une sécurité d’approvisionnement que peu d’autres partenaires pouvaient offrir.
La décision française d’abandonner progressivement ce partenaire naturel au profit des États-Unis soulève un problème écologique majeur. Le transport du GNL américain nécessite de longs trajets transatlantiques, gourmands en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Alors qu’acheminer du gaz algérien ou norvégien par gazoduc consomme environ 0,1 kWh d’énergie par m³, le transport du GNL américain en consomme dix fois plus, soit 1 kWh par m³. L’Agence internationale de l’énergie a déjà confirmé que l’empreinte carbone du GNL est en moyenne 67 % plus élevée que celle du gaz transporté par gazoduc. Selon le cabinet Carbone 4, cette empreinte peut même être 2,5 fois plus élevée.
La nature du gaz accentue encore cet écart. Le GNL américain provient à 79 % du gaz de schiste, dont l’extraction est réputée beaucoup plus polluante que celle du gaz conventionnel. Les fuites de méthane, un gaz dont l’effet de serre est 28 fois plus puissant que celui du CO2 sur un siècle, sont estimées entre 3,6 % et 7,9 % du volume extrait. À l’inverse, le gaz algérien conventionnel présente un bilan environnemental bien plus favorable. Ainsi, la France prend une décision qui, en matière écologique, va à l’encontre de ses propres engagements de neutralité carbone.
Sur le plan économique, les conséquences sont tout aussi lourdes. La distance multipliée par dix entre la France et les États-Unis entraîne une explosion des coûts de transport. Le GNL américain, souvent acheté sur le marché spot, expose en outre la France à une volatilité accrue des prix, contrairement aux contrats à long terme traditionnellement signés avec l’Algérie. Ce surcoût énergétique pénalise directement les industries françaises, déjà confrontées à une forte concurrence internationale. En 2023, ces secteurs avaient émis 33,4 millions de tonnes de CO2, ce qui illustre leur dépendance au gaz naturel. L’agroalimentaire, la chimie ou encore la sidérurgie verront leur compétitivité s’éroder face à des pays voisins bénéficiant de sources d’énergie plus stables et moins coûteuses.
Cette orientation française met aussi en lumière une contradiction stratégique. En substituant une dépendance régionale par une dépendance intercontinentale, la France accroît sa vulnérabilité. Les importations américaines sont soumises aux risques climatiques, notamment les ouragans dans le golfe du Mexique, aux tensions commerciales internationales et aux limites de la flotte mondiale de méthaniers. La décision politique française apparaît ainsi davantage comme une réponse diplomatique ponctuelle à la crise avec l’Algérie que comme une stratégie énergétique rationnelle et durable.
De son côté, l’Algérie n’est pas restée passive face à cette réorientation. Le pays a déjà redirigé ses exportations vers d’autres partenaires, en particulier la Turquie, premier importateur avec 4,05 millions de tonnes en 2024, et l’Italie, qui consolide son rôle de principal partenaire économique régional. L’Algérie mise sur les gazoducs, une solution plus écologique et économiquement avantageuse, confirmant sa volonté d’ancrer sa stratégie énergétique dans la stabilité et la durabilité. La décision de la France isole donc Paris d’un fournisseur proche et fiable au moment où l’Union européenne cherche à réduire sa dépendance au gaz russe.
Cette crise illustre l’impasse d’une stratégie contradictoire. La décision française, dictée par des considérations politiques, alourdit le bilan carbone du pays, fragilise son économie et détériore une relation énergétique historiquement solide avec l’Algérie. Le paradoxe est saisissant : alors que l’Europe recherche des solutions locales et durables pour sécuriser son énergie, la France se détourne d’un partenaire naturel situé à ses portes pour dépendre d’un fournisseur lointain et plus polluant.
L’avenir énergétique français appelle une réflexion plus cohérente. Plutôt que de soumettre son approvisionnement à des tensions diplomatiques passagères, la France gagnerait à privilégier les partenariats les plus rationnels sur le plan économique et environnemental. L’Algérie, de par sa proximité géographique et ses capacités, incarne un partenaire énergétique évident. En prenant une décision qui favorise le GNL américain au détriment du gaz algérien, Paris sacrifie l’efficacité et la durabilité sur l’autel de la politique. La France et l’Algérie partagent pourtant des intérêts convergents : leur coopération pourrait être la clé d’une stratégie énergétique commune et mieux alignée sur les enjeux climatiques mondiaux.