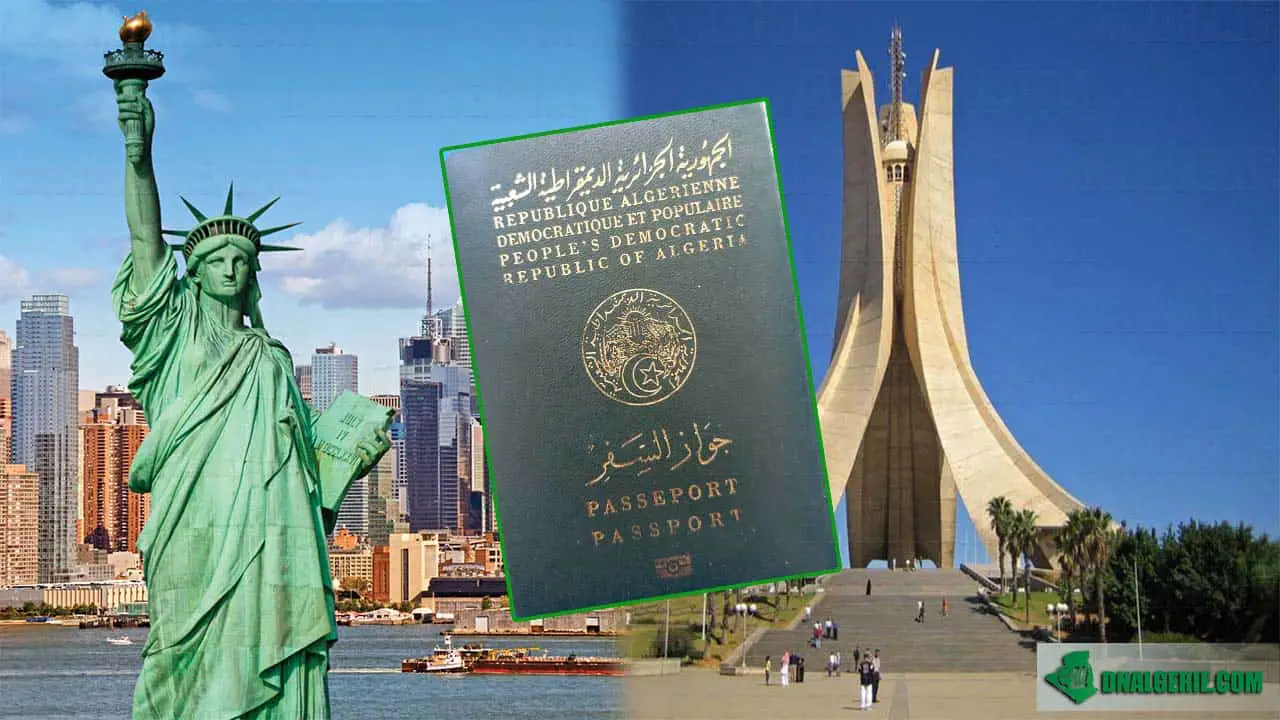Les États-Unis ont introduit de nouvelles règles migratoires qui imposent désormais aux candidats étrangers une évaluation stricte de leur état de santé, touchant directement les Algériens concernés par un projet d’immigration vers les États-Unis, et qui doivent désormais démontrer qu’ils ne présentent pas de pathologies jugées coûteuses par les autorités des États-Unis. Cette nouvelle orientation américaine, qui place les critères médicaux au centre du processus de sélection, a suscité une onde de réaction parmi les Algériens, puisque les États-Unis durcissent encore davantage un système déjà réputé rigoureux.
Selon la directive du département d’État, l’administration Trump exige des consulats et ambassades qu’ils évaluent de manière détaillée la santé des demandeurs. L’obésité, le diabète ou encore certains cancers figurent parmi les affections susceptibles d’entraîner un refus. Ces pathologies sont considérées comme pouvant entraîner des frais médicaux importants pour les États-Unis, ce qui place les Algériens diabétiques ou obèses dans une situation particulièrement délicate lorsqu’ils sollicitent une entrée ou une résidence dans les États-Unis.
La notice, adressée par Marco Rubio à l’ensemble du réseau diplomatique, précise que les agents doivent déterminer si le demandeur ou ses personnes à charge risquent d’avoir besoin de soins spécialisés ou prolongés. Dans ce contexte, les Algériens qui aspirent à rejoindre les États-Unis pour un séjour permanent ou familial se trouvent confrontés à une contrainte nouvelle et inattendue, car les États-Unis considèrent désormais certains profils médicaux comme incompatibles avec les règles migratoires renforcées.
Les pathologies citées dans la directive incluent explicitement le diabète et l’obésité, avec un argumentaire axé sur le coût potentiel des traitements. L’obésité est décrite comme pouvant entraîner apnée du sommeil, hypertension artérielle ou dépression clinique, autant de conditions nécessitant des soins dont les États-Unis préfèrent éviter la prise en charge. Les Algériens, déjà soumis à des délais et procédures complexes pour obtenir un rendez-vous consulaire, découvrent donc un critère supplémentaire qui pourrait empêcher leur installation aux États-Unis, au moment où les États-Unis multiplient les restrictions migratoires.
La décision américaine n’a pas manqué de susciter des critiques. Plusieurs spécialistes du droit de l’immigration ont exprimé leur inquiétude face au pouvoir discrétionnaire accru accordé aux agents consulaires. Ceux-ci pourront désormais refuser un visa pour des motifs médicaux souvent courants. Erin Corcoran, professeure de droit, estime que cette politique vise à compliquer davantage l’accès au territoire, en présentant les candidats comme des risques sanitaires injustifiés. Vic Goel, avocat américain, souligne pour sa part que des problèmes de santé auparavant considérés comme mineurs suffiront désormais à empêcher l’entrée dans le pays.
Le contraste n’a pas échappé aux observateurs : les États-Unis figurent parmi les pays les plus touchés par l’obésité. L’alimentation industrielle et le manque d’activité physique y contribuent largement, donnant lieu à un paradoxe largement relevé par les médias. L’ancien président Donald Trump lui-même avait confirmé en 2024 peser 108 kg pour 1m90, une donnée le plaçant à la limite de la catégorie obèse, après avoir été déclaré « cliniquement obèse » dans un précédent bilan médical. Malgré cela, les règles qu’il soutient aujourd’hui imposent aux étrangers — dont les Algériens — un niveau de santé incompatible avec certaines conditions pourtant fréquentes aux États-Unis.
Pour les Algériens ayant un projet de vie, d’études ou de regroupement familial, cette décision constitue un nouveau défi. Les États-Unis renforcent encore leur politique migratoire, et les Algériens qui envisagent un départ devront désormais prendre en considération non seulement les critères financiers, mais également leur état de santé, devenu un élément déterminant. Les États-Unis poursuivent ainsi une logique entamée depuis 2024, marquée par une sélection plus stricte et une volonté affichée de limiter les admissions jugées coûteuses.
Cette évolution marque un tournant dans les relations migratoires entre les Algériens et les États-Unis, et renforce l’idée d’un tri basé non seulement sur les compétences ou les attaches familiales, mais également sur la capacité du candidat à ne représenter aucune charge médicale future pour les États-Unis. Pour beaucoup d’Algériens, ce changement s’apparente à une nouvelle barrière, symbolique et administrative, dans un contexte mondial où les politiques migratoires se durcissent.