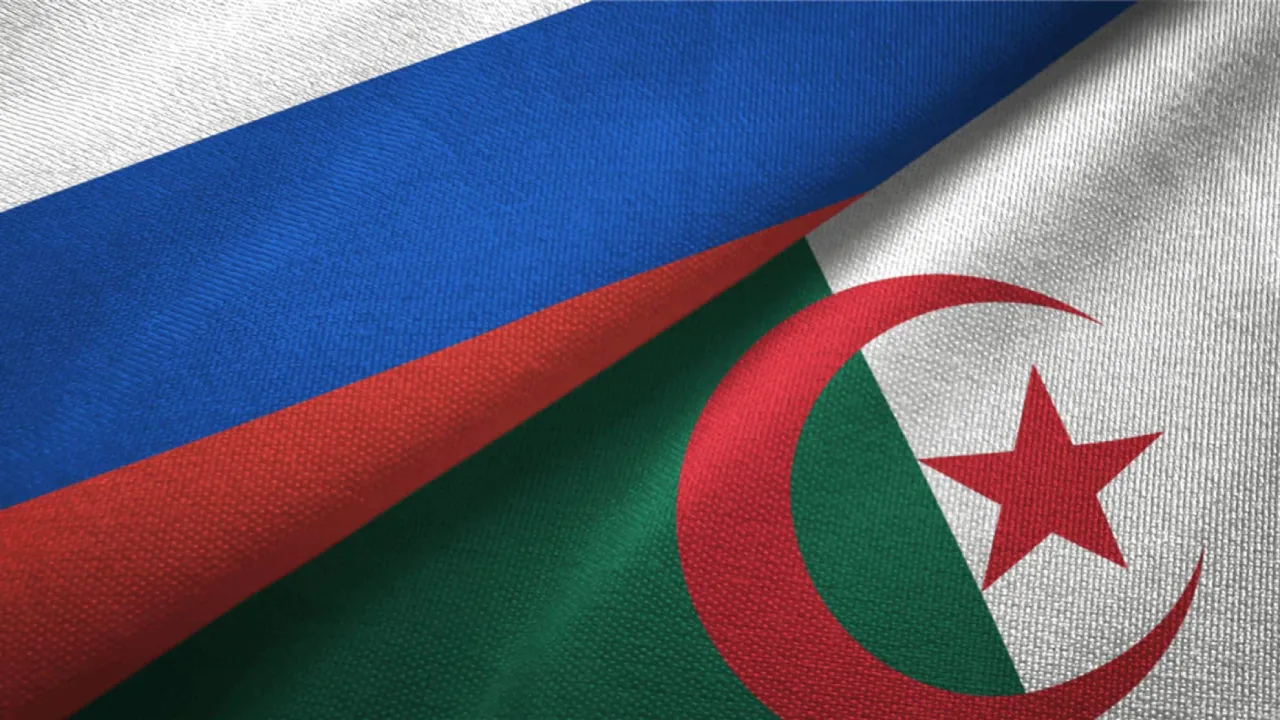L’Algérie renforce significativement sa place dans le paysage énergétique européen en 2025, bouleversant les équilibres établis au profit d’un nouveau rapport de force. Sur fond de tensions géopolitiques persistantes et de redéfinition des partenariats énergétiques, l’Algérie a su tirer parti des opportunités offertes par la conjoncture pour s’imposer comme un acteur central dans l’approvisionnement en gaz naturel. En surpassant la Russie en matière d’exportations via gazoducs, l’Algérie confirme son ancrage stratégique dans les politiques énergétiques de l’Europe, redessinant les contours de la dépendance énergétique sur le continent.
Selon les données publiées par l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), les exportations de gaz naturel par gazoducs en provenance de l’Algérie ont atteint un total de 8,06 milliards de mètres cubes entre janvier et mars 2025. Ce volume dépasse celui de la Russie, pourtant traditionnellement dominante dans ce secteur. Sur cette même période, la Russie, l’Azerbaïdjan et la Libye ont acheminé ensemble 7,1 milliards de mètres cubes vers l’Europe. Le fait que l’Algérie, seule, ait dépassé cette quantité témoigne d’une montée en puissance particulièrement significative dans la hiérarchie des fournisseurs. Cette évolution n’est pas seulement symbolique : elle traduit un rééquilibrage réel et mesurable des flux énergétiques vers l’Europe, avec une Algérie plus visible que jamais sur le radar des décideurs.
La progression des volumes algériens s’est accompagnée d’une croissance remarquable par rapport à l’année précédente. Entre le premier trimestre 2024 et la même période en 2025, les exportations de l’Algérie ont augmenté de 12,6 %, ce qui constitue une performance notable dans un marché souvent soumis à l’instabilité. Les destinations principales de ce gaz algérien restent l’Italie et l’Espagne, deux pays qui ont consolidé leur coopération avec Alger dans le cadre de stratégies de diversification énergétique, et qui cherchent à réduire leur dépendance à la Russie. Cette triangulation entre l’Algérie, la Russie et l’Europe reflète parfaitement la nouvelle dynamique des échanges et des intérêts croisés dans le domaine de l’énergie.
L’Algérie occupe désormais la deuxième position dans le classement des fournisseurs européens par gazoducs, derrière la Norvège, qui reste leader avec ses 21,19 milliards de mètres cubes exportés au cours du premier trimestre 2025. Cependant, le rythme de progression de l’Algérie laisse entrevoir une capacité à stabiliser, voire renforcer encore, cette position dans les mois à venir. En parallèle, la Russie voit sa part se réduire dans un marché européen de plus en plus méfiant à son égard, à cause des aléas géopolitiques et des stratégies de diversification énergétique menées depuis plusieurs années par les pays membres de l’Union européenne.
Ce basculement en faveur de l’Algérie s’appuie également sur des investissements majeurs dans ses infrastructures énergétiques et une volonté politique affirmée de jouer un rôle pivot dans les échanges euro-méditerranéens. Pour l’Europe, cette progression de l’Algérie tombe à point nommé. Le continent cherche activement à réorganiser ses chaînes d’approvisionnement, à renforcer sa résilience énergétique et à se prémunir des risques liés à sa dépendance à la Russie. Ainsi, dans ce triangle énergétique complexe, l’Algérie, la Russie et l’Europe se retrouvent au cœur d’un jeu de pouvoir où la maîtrise des volumes, la stabilité des livraisons et la fiabilité des partenaires deviennent plus déterminants que jamais.
Au-delà des chiffres, c’est toute la perception du rôle de l’Algérie qui évolue. Longtemps considérée comme un fournisseur secondaire face à la Russie, l’Algérie se présente désormais comme une alternative crédible, voire stratégique, pour une Europe en quête de stabilité énergétique. Cette redéfinition des priorités s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition des alliances économiques. En s’imposant face à la Russie sur le terrain des gazoducs, l’Algérie offre à l’Europe une nouvelle voie d’approvisionnement, moins soumise aux aléas politiques d’Europe de l’Est, et plus ancrée dans une logique méditerranéenne.