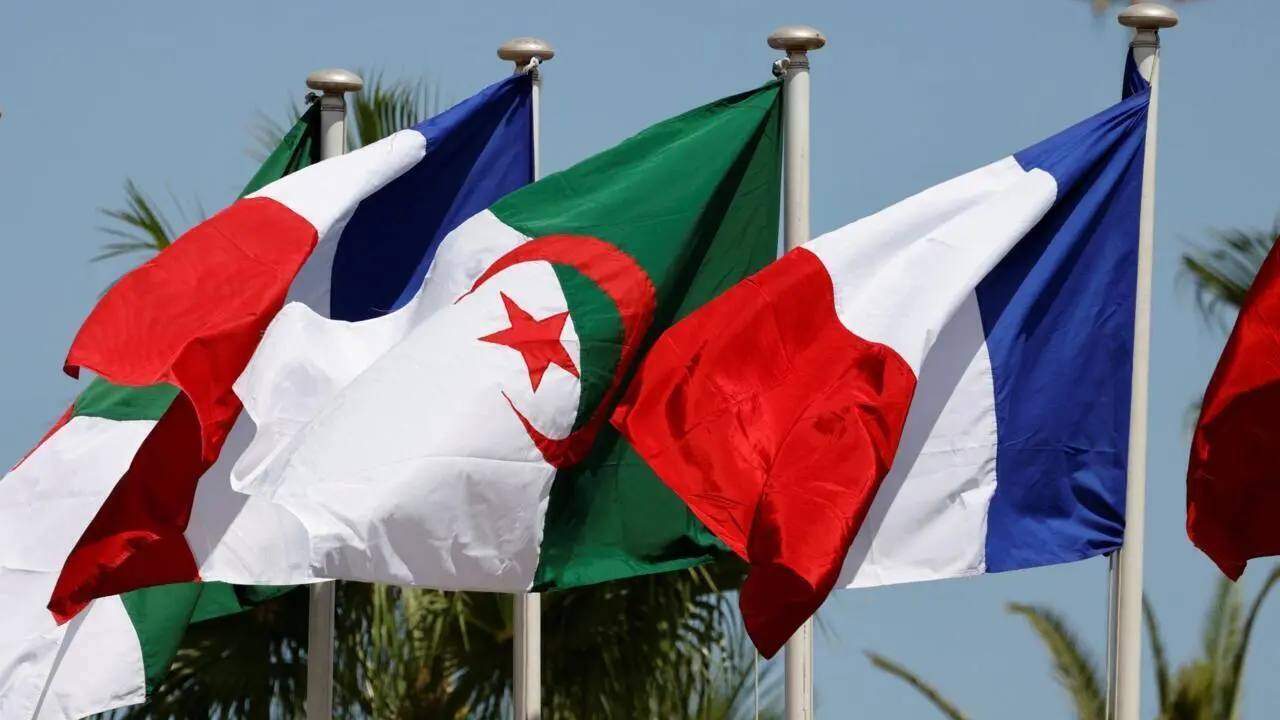Les relations entre la France et l’Algérie traversent une nouvelle phase de turbulence, illustrant une dégradation visible des rapports bilatéraux qui s’étaient, un temps, stabilisés. Ce regain de tension entre la France et l’Algérie repose sur une série d’actes unilatéraux, de décisions administratives et de divergences politiques qui semblent raviver des différends structurels jamais complètement apaisés. Dans un climat déjà chargé, le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué le Chargé d’Affaires de l’ambassade de France à Alger, une démarche diplomatique forte, accompagnée de la remise de deux notes verbales signifiant des décisions lourdes de conséquence.
Selon le communiqué officiel, « la première note verbale a eu pour objet de notifier formellement la dénonciation par la partie algérienne de l’Accord algéro-français de 2013 relatif à l’exemption réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service ». La formule employée ne laisse place à aucune ambiguïté : cette dénonciation met « définitivement un terme à l’existence même de cet accord », rompant ainsi avec un usage diplomatique établi depuis plus d’une décennie. Cette décision ne se limite pas à une suspension temporaire, mais traduit une volonté de reconfiguration totale des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le communiqué précise encore que, « sans préjudice des délais prévus dans l’accord », l’Algérie impose désormais aux détenteurs français de passeports diplomatiques et de service l’obligation de visa. Ce revirement témoigne de la volonté de restaurer une symétrie que les autorités algériennes estiment absente depuis longtemps. « Il s’agit là d’une stricte application du principe de réciprocité », note le texte, soulignant ainsi que l’Algérie considère que la France cherche à imposer « des velléités de provocation, d’intimidation et de marchandage ».
La seconde note verbale remet également en cause un autre aspect crucial des relations France – Algérie : la mise à disposition gratuite de biens immobiliers à l’ambassade de France à Alger. « Les autorités algériennes ont décidé de mettre fin à la mise à disposition, à titre gracieux, de biens immobiliers appartenant à l’État algérien au profit de l’ambassade de France en Algérie », indique la note. Cette décision est accompagnée d’une invitation adressée à la partie française pour entamer des discussions sur les conditions futures de location, avec un réexamen des baux « considérablement avantageux » dont bénéficie actuellement la représentation diplomatique française.
La réciprocité est, ici encore, au cœur de la logique défendue par Alger : « Il y a lieu de rappeler que la représentation diplomatique algérienne en France ne bénéficie d’aucun avantage de cette même nature. » Ce réajustement structurel dans les modalités pratiques de la diplomatie entre les deux pays s’inscrit dans un climat général de déséquilibre ressenti par l’Algérie, qui entend « introduire l’équilibre et la réciprocité dans la relation algéro-française globale ».
L’ampleur de la crise ne se limite cependant pas à des considérations logistiques ou administratives. Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué distinct, daté du 7 août 2025, dans lequel il apporte une réponse détaillée à un message transmis par le président de la République française à son Premier ministre. Ce document, transmis à l’ambassade algérienne à Paris, a été étudié « avec attention » par les autorités algériennes, révélant « un ensemble de remarques importantes ».
La première de ces remarques concerne l’analyse faite par Paris de la détérioration des relations entre la France et l’Algérie. Le message du président français « attribue, de manière implicite mais claire, la pleine responsabilité de la dégradation des relations bilatérales au côté algérien », selon le communiqué. Les autorités algériennes y voient une « minimisation des faits », une « déformation de la réalité », et une occultation « des démarches objectives menées à toutes les étapes » par l’Algérie. Ces dernières ont été « accompagnées de données officielles et de preuves solides », alors que les réactions françaises ont été jugées marquées par « une logique d’escalade », déconnectée de toute volonté d’apaisement.
Le document poursuit en accusant la France de rompre ses engagements bilatéraux, en citant nommément plusieurs textes internationaux : « L’accord algéro-français de 1968 sur la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens », « l’accord consulaire de 1974 », et « l’accord de 2013 concernant les visas et les passeports diplomatiques ». Tous auraient, selon Alger, été violés de manière répétée par Paris. À cela s’ajoute la dénonciation d’une « ignorance totale » de l’accord de 1994 sur l’extradition des criminels algériens détenus en France, ainsi que des violations présumées de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
Ce cadre normatif est au cœur de la position algérienne : la France est accusée de ne pas respecter les droits des citoyens algériens résidant sur son territoire, notamment en limitant leur accès aux recours administratifs et judiciaires. Le communiqué souligne que cette situation « constitue une atteinte claire à leur droit à la protection », pourtant garanti par les traités européens. La « responsabilité de cette violation repose entièrement sur l’État français », insiste le texte.
En matière de visas, autre sujet de discorde récurrent dans les relations entre la France et l’Algérie, le gouvernement algérien dénonce une instrumentalisation politique du dispositif dit « visa contre réadmission ». Il juge cette pratique en « violation claire » de l’accord de 1968 et de la Convention de 1950. L’Algérie déclare son intention de « continuer à s’engager pour défendre les droits de ses citoyens en France », notamment par « une protection juridique renforcée contre toute forme d’abus ou d’expulsion arbitraire ».
Le différend s’étend également à une procédure unilatérale mise en place par la France, concernant l’approbation préalable des passeports diplomatiques. Une telle mesure n’a jamais fait l’objet d’un accord, souligne le texte, et l’Algérie n’a pas été consultée ni même informée. « Cette décision reste donc unilatérale et sans effet », tranche le ministère.
Au-delà de cette série de griefs, l’Algérie ne ferme pas la porte au dialogue. Le communiqué conclut en rappelant que la lettre du président français évoque « un certain nombre de différends qu’il convient de résoudre ». L’Algérie, pour sa part, « réaffirme sa volonté de traiter tous les différends avec la France par les voies diplomatiques », et appelle Paris à « faire preuve de la même volonté pour parvenir à des solutions durables ».
Cette séquence diplomatique illustre à quel point les relations entre la France et l’Algérie demeurent fragiles. Malgré l’histoire partagée, les enjeux migratoires, économiques, sécuritaires et culturels qui lient les deux pays, les relations France – Algérie ne cessent de traverser des phases de crispation, révélant l’absence d’un cadre stabilisateur suffisamment robuste. La relation bilatérale, complexe et parfois ambivalente, nécessite aujourd’hui plus que jamais une clarification des règles du jeu, et surtout une volonté politique mutuelle de bâtir un nouveau pacte basé sur le respect, l’égalité et la confiance.
Dans cette optique, le rappel par l’Algérie du principe de réciprocité apparaît comme une ligne rouge indépassable, tandis que la France, elle, semble maintenir une lecture souveraine de ses engagements. Tant que ces deux approches resteront inconciliables, les relations entre la France et l’Algérie risquent de continuer à se tendre, alimentant des tensions dont les effets se répercutent bien au-delà du cadre diplomatique.