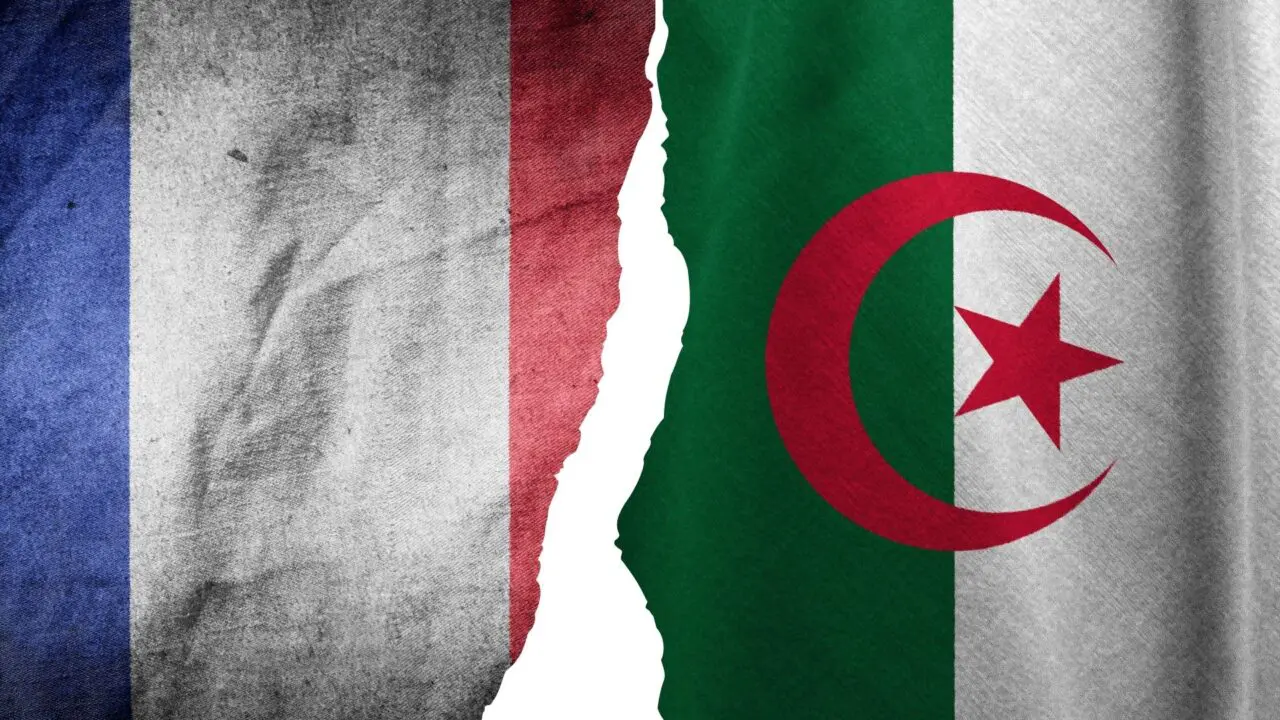Dans un entretien accordé au média français Le Monde, l’historien Benjamin Stora, spécialiste reconnu de l’histoire de l’Algérie contemporaine et des relations franco-algériennes, a proposé une piste de sortie face à la crise que traversent la France et l’Algérie depuis près de dix mois. Selon lui, le travail de mémoire autour de la colonisation en Algérie constitue « un élément possible de sortie de crise, de toute façon indispensable, de toute façon nécessaire ». Cette crise, qualifiée d’« inédite » par l’historien, s’est aggravée à la suite du soutien affiché par le président Emmanuel Macron au plan d’autonomie marocain au Sahara occidental, un geste perçu comme une rupture stratégique dans l’équilibre diplomatique régional.
Benjamin Stora rappelle que la crise entre la France et l’Algérie, bien que ponctuée de phases de réchauffement, reste marquée par une histoire longue de 132 ans de colonisation. Il insiste sur le fait qu’« on ne peut pas régler par un seul discours, par un seul geste, des rapports qui ont duré 132 ans ». À ses yeux, la crise entre la France et l’Algérie n’est pas seulement politique ou diplomatique, mais elle est aussi profondément mémorielle, enracinée dans un passé douloureux qui ressurgit régulièrement. « Il est évident qu’il y a (…) des batailles politiques, où chacun (…) trouve un peu son compte (…) en entretenant la flamme d’une mémoire douloureuse », affirme-t-il, dénonçant une instrumentalisation politique de cette mémoire des deux côtés de la Méditerranée.
L’historien évoque également les responsabilités partagées dans cette situation. Du côté français, il cite notamment des figures politiques comme Bruno Retailleau, dont la campagne à la présidence du parti Les Républicains a été marquée par des discours appelant à l’« extrême fermeté » vis-à-vis d’Alger. Du côté algérien, il souligne que certaines personnalités appellent à une rupture complète des liens avec la France, même si elles ne représentent pas une majorité. Il estime que « cette fois, c’est totalement inédit », car la crise « s’installe dans la durée », contrairement aux crises antérieures souvent ponctuelles.
Le cœur de sa proposition repose sur la poursuite du travail de mémoire. Il rappelle les reconnaissances déjà opérées par l’État français, comme l’assassinat de figures historiques telles que Maurice Audin, Ali Boumendjel ou Larbi Ben M’hidi. Cependant, il souligne que ces reconnaissances demeurent insuffisantes : « Il faudrait des gestes forts, notamment sur la question du XIXe siècle ». À son sens, ce travail de mémoire ne peut être un simple substitut à une politique claire. « Envisager la possibilité de gestes mémoriels \[pour sortir de cette crise], ce serait une sorte de substitut à une reprise de lien politique », explique-t-il, avant de pointer l’importance cruciale de la circulation des personnes entre la France et l’Algérie. « À mon sens, le point le plus important va être le problème de la circulation des personnes entre les deux rives de la Méditerranée », ajoute-t-il.
Stora insiste sur la nécessité de patience et de volonté politique. Il évoque une relation « parsemée de troubles, de cycles », entre crispations et tentatives de dégel. Selon lui, « il faut être patient et avancer pas à pas (…) avec la volonté politique de régler » cette crise « dans la longue durée ». Cette persistance du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie est d’autant plus préoccupante qu’elle affecte des centaines de milliers de personnes qui « circulent sans cesse entre la France et l’Algérie ou entre l’Algérie et la France ». Pour l’historien, cette interdépendance humaine rend difficile toute rupture diplomatique formelle, comme une fermeture d’ambassades ou une suspension totale des relations.
Enfin, Benjamin Stora, dans cet entretien au Monde, rappelle que la mémoire agit comme « des fantômes dans les placards ». Même lorsqu’on croit avoir fermé le chapitre, « la mémoire revient quand même ». Il en appelle donc à une démarche sincère, assumée, appuyée par des gestes symboliques mais aussi des politiques concrètes. Car la crise entre la France et l’Algérie, en l’absence d’un travail de mémoire abouti, risque de se raviver « à chaque fois », retardant ainsi toute normalisation durable.