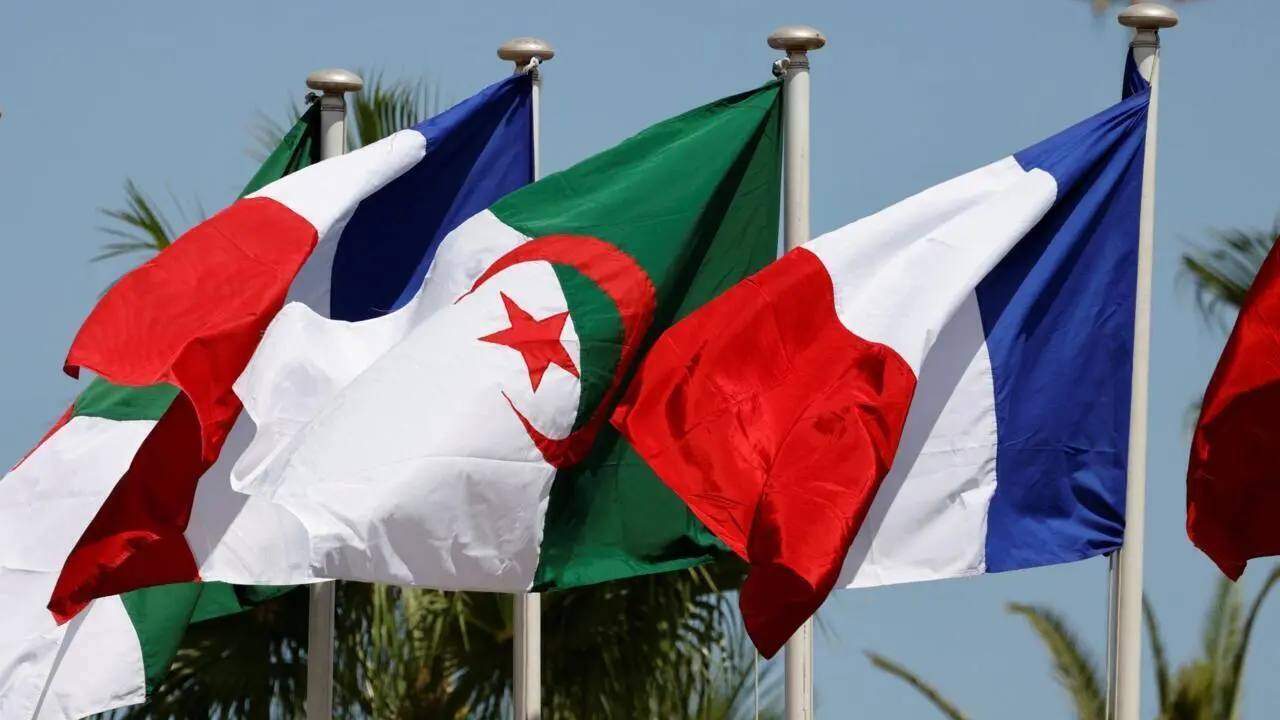La colonisation française en Algérie a laissé derrière elle une multitude de cicatrices, dont certaines restent méconnues du grand public. L’une d’elles concerne l’exploitation massive du liège algérien, un pillage organisé qui a profondément marqué l’environnement et l’économie du pays. Dans un récent article, l’agence officielle Algérie Presse Service (APS) a mis en lumière cette spoliation qui s’est déroulée sur plus d’un siècle. Selon l’APS, « le liège algérien a subi, pendant 132 ans, la gestion hasardeuse de l’administration coloniale et la surexploitation effrénée. »
Dès les premières années de l’occupation française, la forêt algérienne a été identifiée comme une ressource précieuse. Les vastes étendues de chênes-lièges, qui s’étendaient sur environ 400 000 hectares, ont suscité la convoitise des colons qui y voyaient un potentiel économique immense. « Sous le prétexte d’une ‘foresterie rationnelle’, l’administration coloniale a mis en œuvre un plan de mainmise sur les forêts, en particulier celles de chêne-liège, dont la rentabilité mondiale croissante était perçue comme une opportunité lucrative », souligne l’APS. Cette exploitation était dictée par des intérêts purement économiques, sans prise en compte des conséquences écologiques et sociales.
Dès 1840, la France met en place un système de concessions, permettant à des entreprises privées, souvent détenues par des Européens, de tirer profit de cette manne naturelle. « Un régime de concessions avec redevance a été instauré pour les forêts de chênes lièges, cédées à des concessionnaires privés majoritairement français et européens », précise l’APS. Ces concessions, initialement accordées pour 16 ans, sont progressivement allongées à 40 puis 90 ans, garantissant ainsi un contrôle à long terme sur cette richesse naturelle.
Au fil des décennies, la production de liège explose. En 1847, l’Algérie coloniale produit déjà 447 quintaux de liège brut, un chiffre qui ne cessera d’augmenter. « Entre 1900 et 1915, la surface productive est passée de 200 000 à 250 000 hectares, avec un rendement moyen par hectare d’environ 60 kg », rapporte l’APS. Cette frénésie d’exploitation atteint son paroxysme dans les années 1930, lorsque la production dépasse les 300 000 quintaux. En 1937, un record historique est atteint avec 553 919 quintaux extraits des forêts algériennes.
Cette surexploitation a des conséquences désastreuses sur l’écosystème algérien. « Après cent ans de colonisation de l’Algérie et d’exploitation irrationnelle du liège algérien, les constats d’administrateurs forestiers coloniaux relevaient ‘un épuisement des peuplements de chêne-liège' », mentionne l’APS. Les arbres, incapables de se régénérer correctement en raison de l’absence d’une gestion durable, voient leur population décliner drastiquement. Les forêts, autrefois denses et prospères, se retrouvent appauvries, mettant en péril la biodiversité locale.
L’impact social est tout aussi dramatique. Le régime colonial a progressivement restreint l’accès aux forêts pour les populations locales, privant ainsi les Algériens de cette ressource vitale. « Des lois ont progressivement restreint l’accès à ces espaces pour les Algériens », explique l’APS. Cette marginalisation s’accompagne d’une privation de revenus pour les artisans locaux qui vivaient de l’exploitation raisonnée du liège bien avant l’arrivée des colons.
Outre l’exportation brute de cette ressource, la colonisation a également vu l’émergence d’une industrie de transformation du liège en Algérie. « Autour du liège algérien, l’administration française avait encouragé l’émergence d’une industrie de transformation et des usines ont été ouvertes dans plusieurs régions notamment à Alger, Béjaïa, Jijel et Collo », détaille l’APS. Cette industrialisation a surtout profité aux colons qui, maîtrisant les circuits économiques et les infrastructures, ont su capter la majeure partie des bénéfices.
L’histoire du pillage du liège en Algérie s’inscrit dans un cadre plus large de spoliation des richesses naturelles du pays par la puissance coloniale. Elle illustre non seulement l’exploitation économique systématique mise en place par la France, mais aussi les ravages écologiques et sociaux laissés en héritage. Aujourd’hui encore, les forêts de chênes-lièges en Algérie portent les stigmates de cette surexploitation, et les efforts pour restaurer ces écosystèmes endommagés se poursuivent.
Cette révélation de l’APS vient ainsi rappeler une page sombre de l’histoire algérienne, où une ressource précieuse a été accaparée au détriment des populations locales. Loin d’être un simple chapitre du passé, cette histoire résonne encore dans les débats actuels sur l’exploitation des ressources naturelles et les séquelles laissées par la colonisation. La prise de conscience de ces faits est essentielle pour comprendre les défis environnementaux et économiques que l’Algérie continue de relever aujourd’hui.
Lire également :
«La France est attachée à sa relation avec l’Algérie» : le MAE français Jean-Noël Barrot catégorique
France – Algérie : Sabrina Sebaihi propose des solutions pour sortir de la crise
Aéroport de Paris Roissy : une responsable met en garde les Algériens