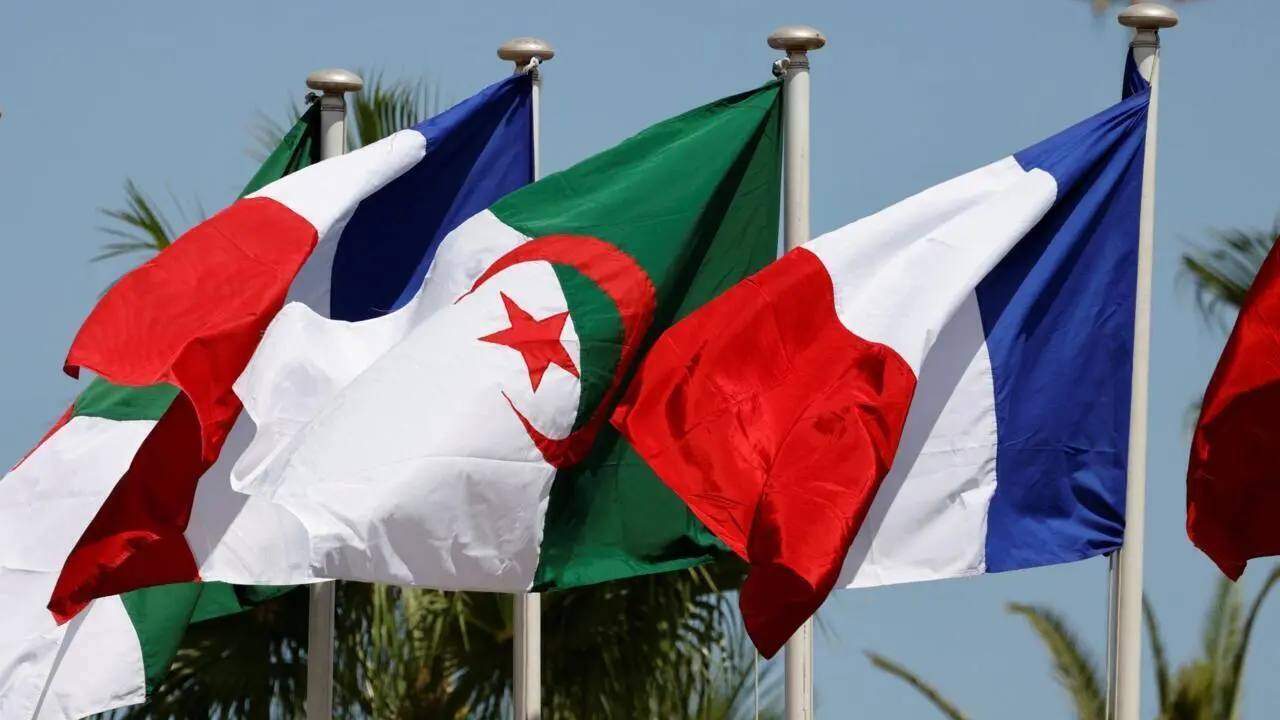La France, par l’intermédiaire de son organisme public Team France Export, s’intéresse de près à un produit stratégique cultivé en Algérie : la pomme de terre. Dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques entre Alger et Paris, cette attention particulière met en lumière l’importance économique et alimentaire d’un produit qui occupe une place centrale dans l’agriculture algérienne. Team France Export, chargé d’accompagner les entreprises françaises à l’international, estime que ses partenaires peuvent contribuer au développement de la filière pomme de terre en Algérie, tout en bénéficiant d’un accès privilégié à un marché en expansion. L’analyse menée par les équipes de Team France Export en Algérie repose sur une étude approfondie réalisée en juin dernier et relayée auprès de leurs entreprises adhérentes, avec des conclusions qui soulignent à la fois les faiblesses actuelles et les opportunités à saisir.
Le diagnostic s’appuie notamment sur les travaux du Centre de recherche en économie appliquée au développement (CREAD), qui a récemment organisé une rencontre scientifique autour de la filière pomme de terre en Algérie, sous le thème « Facteurs de (dé) régulation et stratégie des acteurs ». Les experts insistent sur la nécessité de réduire la dépendance excessive à l’égard des semences importées et de renforcer la capacité locale de production. Selon les chiffres avancés, la consommation moyenne de pomme de terre en Algérie atteignait en 2018 près de 110 kg par habitant et par an, ce qui témoigne de l’importance de ce produit dans le régime alimentaire national. L’omelette accompagnée de frites s’impose ainsi comme un incontournable pour les jeunes générations, tandis que le couscous reste un plat emblématique. Afin de répondre à cette forte demande, les services agricoles prévoient pour la saison 2024-2025 une récolte estimée à 11,5 millions de quintaux.
Team France Export met en avant plusieurs contraintes structurelles rencontrées par la production en Algérie. La dépendance aux semences importées reste un problème majeur, auquel s’ajoutent le coût élevé des engrais et des pesticides. Le CREAD a mis en évidence certaines pratiques d’adaptation développées par les producteurs locaux, comme la production dite de « semences de ferme », qui consiste à réutiliser une partie de la récolte principale pour l’arrière-saison. Ce système, notamment appliqué dans le bassin agricole d’El Oued, représente une alternative intéressante mais comporte aussi des risques, notamment liés à la propagation de virus transmis par les pucerons, lesquels se conservent facilement dans les tubercules. C’est pourquoi certaines entreprises en Algérie, comme Agrodev, Sodea ou Vitroplant, ont recours à des techniques de culture in vitro pour assurer une meilleure qualité sanitaire des plants.
Face à ces défis, Team France Export souligne que le développement de semences locales performantes constitue une priorité. Selon l’organisme, la France dispose d’un savoir-faire technique reconnu qui pourrait être transféré en Algérie, notamment à travers la formation des agriculteurs aux méthodes agricoles modernes et durables. Le travail d’épuration au champ, visant à éliminer les plants virosés, apparaît indispensable pour garantir la qualité des récoltes. Dans la presse spécialisée, un agriculteur français expliquait récemment que son métier était de produire des plants exempts de maladies, et non pas des pommes de terre de consommation, ce qui illustre bien la spécialisation et la technicité exigées par la filière semencière.
En matière de perspectives, Team France Export insiste également sur le besoin urgent d’investissements dans les équipements modernes. L’Algérie, malgré une mécanisation partielle de la plantation, reste dépendante du travail manuel lors du ramassage des tubercules. Après le passage des arracheuses mécaniques, les ouvriers agricoles, souvent payés à la tâche, ramassent encore les pommes de terre à la main, agenouillés des heures durant pour remplir un maximum de caisses. L’organisme français considère que cette situation traduit un retard structurel qui peut être comblé grâce à des partenariats stratégiques. Il propose donc aux entreprises françaises spécialisées de s’engager dans la fourniture de systèmes d’irrigation avancés, de machines de récolte performantes et d’installations de stockage adaptées, afin de réduire les pertes post-récolte.