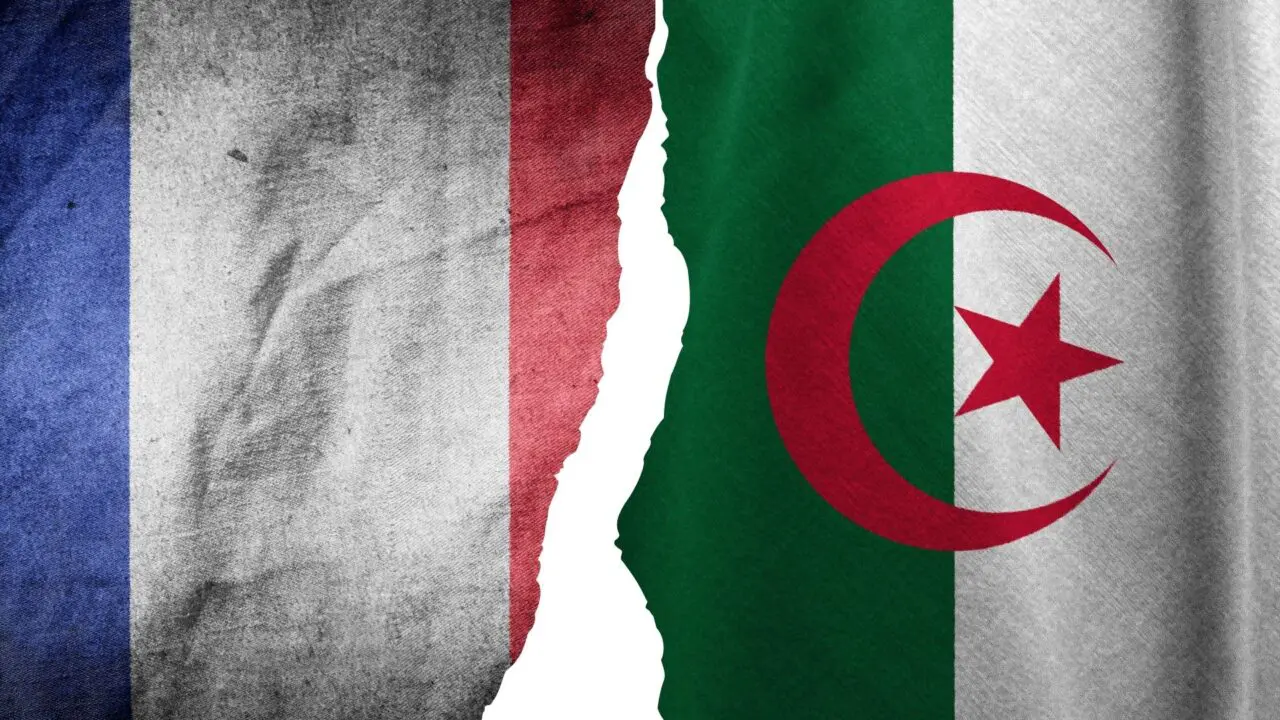La tension entre la France et l’Algérie connaît un nouveau rebondissement avec la décision rendue publique le 14 mai par la cour d’appel de Paris, au sujet du MAK. Cette dernière a refusé la demande d’extradition formulée par l’Algérie à l’encontre d’Aksel Bellabbaci, figure centrale du MAK, mouvement indépendantiste kabyle classé comme organisation terroriste par les autorités algériennes. Ce refus de la France intervient dans un climat déjà alourdi par des désaccords persistants entre les deux pays sur de nombreuses questions sensibles, illustrant une fois de plus la complexité des relations diplomatiques franco-algériennes.
La justice française a estimé que la demande d’extradition transmise par l’Algérie était juridiquement « sans objet », une formulation qui, sans entrer dans les détails, souligne le caractère irrecevable ou insuffisamment fondé de la requête. Aksel Bellabbaci, en tant que numéro deux du MAK, est visé par une condamnation à la réclusion à perpétuité en Algérie, notamment pour son implication présumée dans les incendies meurtriers qui ont ravagé la région de Kabylie durant l’été 2021.
Selon les autorités algériennes, ces incendies, qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes et dévasté des milliers d’hectares, seraient le fruit d’actes délibérés orchestrés en partie par des membres influents du MAK. L’Algérie considère donc le rôle d’Aksel Bellabbaci comme central dans ces événements tragiques. Mais en France, le MAK est perçu différemment. Ni interdit, ni classé comme terroriste sur le territoire français, le mouvement bénéficie d’un certain nombre de protections juridiques.
Ce n’est pas la première fois que la France rejette une demande d’extradition de l’Algérie concernant une figure controversée. Avant le cas du MAK, la France avait déjà refusé d’extrader Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie, condamné à de lourdes peines en Algérie pour corruption. Ces refus successifs alimentent l’idée d’un déséquilibre entre les attentes exprimées par l’Algérie et les réponses fournies par la France, accentuant une méfiance déjà bien enracinée. Cette situation met en évidence le rôle délicat de la justice dans les relations bilatérales, où les intérêts politiques et les principes juridiques ne coïncident pas toujours.
Pour l’Algérie, le MAK incarne un défi majeur à l’unité nationale. Les demandes adressées à la France ne relèvent donc pas seulement d’un processus judiciaire, mais participent d’une démarche politique visant à renforcer la souveraineté nationale et à réprimer ce que l’État algérien qualifie d’activités terroristes. Mais du côté français, la perception est plus nuancée : la justice doit examiner les faits de manière indépendante, en s’assurant que les droits fondamentaux des personnes concernées sont respectés, sans que les considérations politiques ne pèsent sur les décisions.
Ce refus d’extradition vient donc s’ajouter à une série de malentendus qui compliquent davantage la coopération entre les deux pays. Pour l’Algérie, il s’agit d’un coup dur porté à ses efforts de lutte contre les réseaux qu’elle accuse de semer le trouble et de menacer la stabilité nationale.
Le cas Bellabbaci n’est donc pas un simple contentieux judiciaire, mais bien le reflet d’un différend profond et durable qui oppose le regard de la France à celui de l’Algérie sur des questions de sécurité, de justice et de souveraineté. Ce nœud diplomatique, autour du MAK, entre la France et l’Algérie, continue d’alimenter les débats et d’illustrer les limites actuelles du dialogue bilatéral.