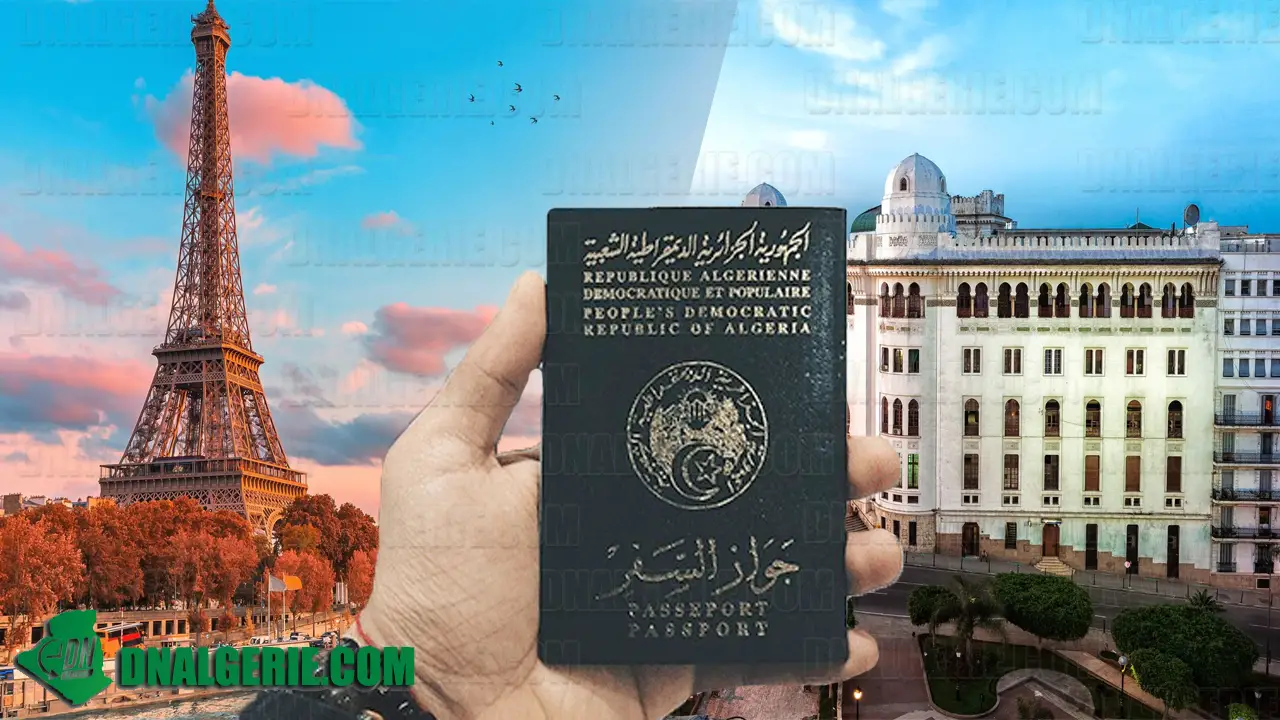Depuis la signature de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les droits d’un Algérien en France s’inscrivent dans un cadre juridique particulier qui continue de s’appliquer aujourd’hui. Cet accord, toujours en vigueur, fixe les modalités de circulation, d’emploi et de séjour des ressortissants algériens, en leur accordant un statut distinct des autres étrangers. Concrètement, les droits d’un Algérien en France sont reconnus sur la base d’un traitement dérogatoire au droit commun, consolidé par plusieurs avenants mais parfois aussi affaibli au fil des décennies. Ce dispositif bilatéral donne ainsi aux citoyens algériens une série d’avantages spécifiques, encadrés par la législation française.
L’un des droits majeurs pour un Algérien vivant en France réside dans l’obtention facilitée du certificat de résidence. En effet, un Algérien peut bénéficier en France, de plein droit, d’un certificat de résidence d’un an ou de dix ans, selon ses liens familiaux ou personnels. Ce titre permet non seulement de résider légalement, mais aussi d’accéder plus facilement aux dispositifs d’intégration et aux services administratifs. Ces droits spécifiques accordés à un Algérien en France se traduisent par des délais de traitement souvent plus courts et une simplification des procédures, en comparaison avec celles imposées aux autres ressortissants non européens.
Le monde du travail représente également un champ d’application concret de ces droits. Lorsqu’un travailleur algérien est recruté en France, il peut prétendre à un titre de séjour temporaire accompagné d’une autorisation de travail, sans que la situation du marché de l’emploi ne soit un obstacle. Ce droit permet à un Algérien de venir en France pour exercer un emploi dans un cadre réglementaire clair. Le contrat de travail, une fois validé par la DIRECCTE, débouche sur la délivrance d’un visa long séjour mention « travailleur temporaire », suivi d’un certificat de résidence valable jusqu’à deux ans. Là encore, les droits d’un Algérien sont reconnus dans un cadre spécifique, distinct du droit commun.
En matière familiale, l’accord de 1968 prévoit également des droits adaptés pour les Algériens souhaitant vivre en France avec leurs proches. Le regroupement familial est facilité par des conditions allégées, notamment en ce qui concerne le niveau de ressources requis et la surface du logement. Les conjoints et enfants mineurs d’un Algérien déjà installé en France peuvent ainsi bénéficier d’un droit d’entrée et de séjour plus accessible, ce qui renforce les liens familiaux et favorise une meilleure intégration sociale.
Du point de vue juridique, l’accord reconnaît que les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), en particulier l’article 32, ne s’appliquent pas aux Algériens. Autrement dit, les droits d’un Algérien en France continuent d’être régis exclusivement par cet accord bilatéral. Toutefois, la préfecture peut toujours faire usage d’un pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation, notamment pour des motifs humanitaires ou personnels. Ce pouvoir d’appréciation permet de prendre en compte les situations individuelles, au-delà des textes.
Mais malgré ces avantages encore en place, les droits d’un Algérien en France ont été progressivement réduits. Trois avenants, signés respectivement en 1985, 1994 et 2001, ont restreint certains aspects de l’accord, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation ou les conditions d’installation. Ces ajustements ont eu pour effet de rapprocher, dans certains cas, le régime des Algériens de celui applicable aux autres étrangers hors Union européenne. Si certaines différences persistent, l’écart entre les régimes tend à se réduire.
Il est à noter toutefois que certains droits restent plus avantageux pour un Algérien en France. Par exemple, après un an de mariage avec un ressortissant français ou à l’issue de douze mois de regroupement familial, il est possible pour un Algérien de demander une carte de résident valable dix ans. Cette durée est supérieure à celle prévue pour d’autres étrangers dans des cas similaires, où il faut souvent patienter dix-huit mois. Pourtant, certains observateurs qualifient aujourd’hui l’accord de « vidé de toute sa substance », soulignant l’évolution restrictive des politiques migratoires en France.
Ainsi, bien que le cadre juridique de l’accord de 1968 soit encore applicable, les droits d’un Algérien en France reposent désormais sur un équilibre fragile entre privilèges hérités du passé et ajustements contemporains. Ces droits, liés à la résidence, au travail ou à la famille, continuent de faire l’objet d’interprétations diverses, et leur portée réelle dépend souvent des décisions administratives locales. Pour un Algérien vivant en France, il reste donc essentiel de bien connaître le contenu et les évolutions de cet accord unique, afin de faire valoir pleinement ses droits dans un environnement juridique en mutation constante.