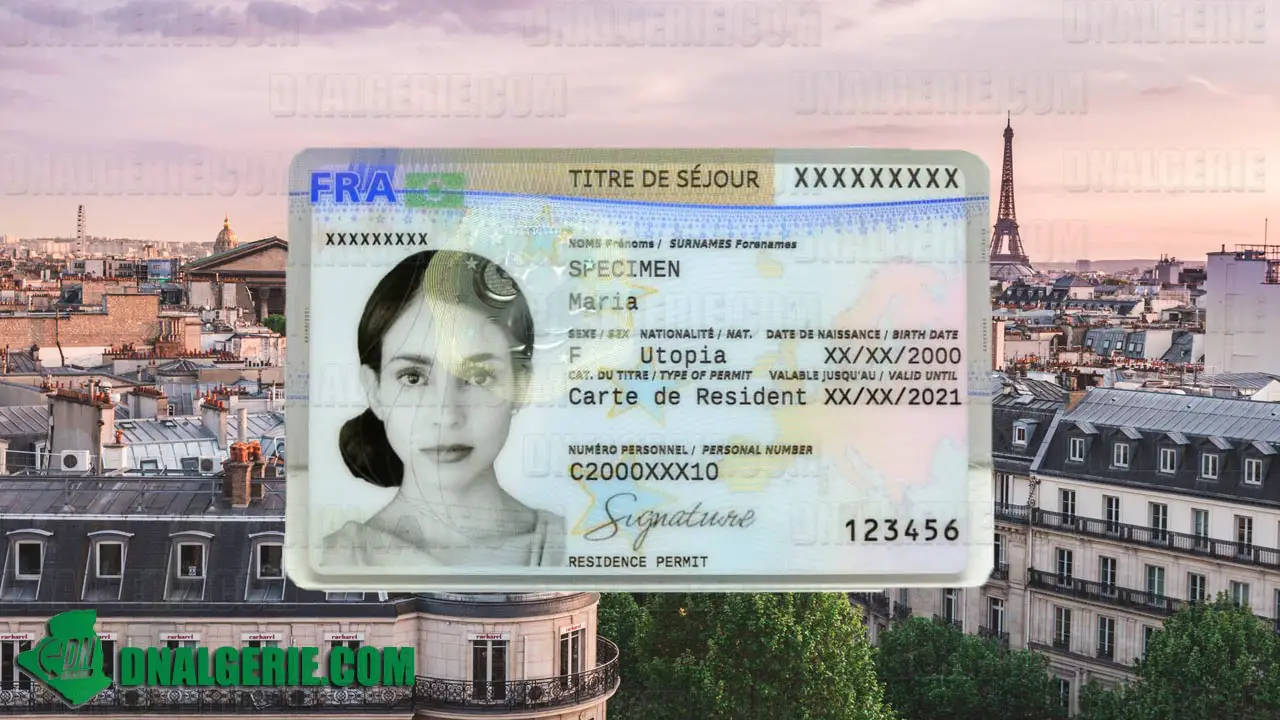Après s’être acharnée sur les Algériens, voilà que la France cible désormais les Tunisiens, notamment à travers la remise en question des modalités d’attribution des titres de séjour. Devant le Maroc et l’Algérie, la Tunisie est aujourd’hui le premier pays source d’immigration maghrébine en France, une évolution démographique qui soulève de multiples débats sur l’intégration et la gestion des flux migratoires. Les chiffres de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, publiés dans une étude relayée par Le Figaro, mettent en évidence une tendance sans précédent.
En l’espace de vingt ans, l’immigration tunisienne en France a enregistré la croissance la plus rapide parmi les pays du Maghreb. Ce constat est lié à plusieurs facteurs, notamment les accords bilatéraux entre Paris et Tunis qui ont favorisé l’arrivée de travailleurs dans un cadre légal. Cependant, cette dynamique a aussi révélé les limites de la coopération diplomatique lorsqu’il s’agit de gérer l’immigration illégale et les difficultés économiques qui ralentissent l’intégration sociale. L’enjeu dépasse le simple nombre de titres de séjour attribués, car il illustre un phénomène structurel touchant à la fois la démographie, l’emploi et l’équilibre social.
En 2023, la France comptait officiellement 347 000 immigrés tunisiens, un chiffre en hausse de 52,6 % depuis 2006. Cette augmentation fait des Tunisiens la communauté dont la croissance est la plus rapide dans l’espace maghrébin, presque deux fois plus élevée que celle des Algériens. Les Tunisiens se distinguent aussi par le taux le plus élevé de nouveaux titres de séjour rapporté à leur population : 182 pour 100 000 habitants en 2024, soit trois fois plus que l’Algérie. Ces données montrent l’ampleur du phénomène migratoire qui ne cesse de progresser malgré les politiques restrictives mises en place.
Cette progression est renforcée par la natalité de la diaspora. Une statistique révélée par l’OID illustre ce phénomène : 57 % des Tunisiennes arrivant pour la première fois en France ont un enfant dans les quatre ans suivant leur installation, alors que l’indice de fécondité en Tunisie est descendu à 1,8. Cette différence entre la situation démographique en Tunisie et en France révèle l’importance des dynamiques familiales dans le maintien d’un flux migratoire constant.
Depuis 1988, et plus encore depuis la révision de l’accord-cadre de 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l’État français avait affiché l’ambition de réorienter l’immigration tunisienne vers un modèle économique dit « choisi ». Pourtant, la réalité des chiffres montre que l’immigration familiale continue de dominer. En 2024, 35,7 % des premiers titres de séjour délivrés aux Tunisiens l’étaient pour des motifs économiques, tandis que 38,3 % relevaient du regroupement familial. Autrement dit, la part de l’immigration familiale reste plus importante que celle liée au travail, contrairement aux objectifs initialement fixés par Paris.
Sur le terrain de l’intégration, les difficultés persistent. En 2022, 34,8 % des étrangers tunisiens âgés de 15 ans et plus vivant en France n’étaient ni en emploi, ni en études, ni à la retraite, contre 12,6 % des Français de naissance. Le décalage est encore plus marqué lorsqu’on observe le niveau scolaire : près de 40 % des immigrés tunisiens et marocains n’avaient pas de diplôme ou seulement un niveau équivalent au brevet, contre 13,5 % pour la population française sans ascendance migratoire. Ces indicateurs traduisent des obstacles économiques et sociaux persistants malgré les politiques d’accompagnement mises en place.
À cela s’ajoute un problème diplomatique que Paris n’a pas encore réussi à résoudre. En 2024, plus de 13 000 Tunisiens en situation irrégulière ont été interpellés en France, ce qui place la Tunisie au premier rang des pays du Maghreb en matière de sans-papiers rapportés à sa population immigrée. Cependant, les expulsions effectives restent limitées : la Tunisie n’arrive qu’au cinquième rang des nationalités les plus reconduites. Ce décalage entre interpellations et reconduites traduit les difficultés de coopération entre les autorités françaises et tunisiennes en matière de réadmission.
L’OID résume la situation en soulignant un déséquilibre : la France a multiplié les voies légales d’immigration en facilitant l’accès aux titres de séjour pour les Tunisiens, mais elle n’a pas réussi à contrôler efficacement l’immigration irrégulière. Le résultat est un système où la progression démographique des Tunisiens en France ne correspond pas aux attentes initiales d’une immigration avant tout économique. La question reste donc ouverte : comment concilier les besoins économiques, les contraintes sociales et la coopération diplomatique, alors que la France, après avoir ciblé les Algériens, oriente désormais son attention vers les Tunisiens dans sa politique migratoire.