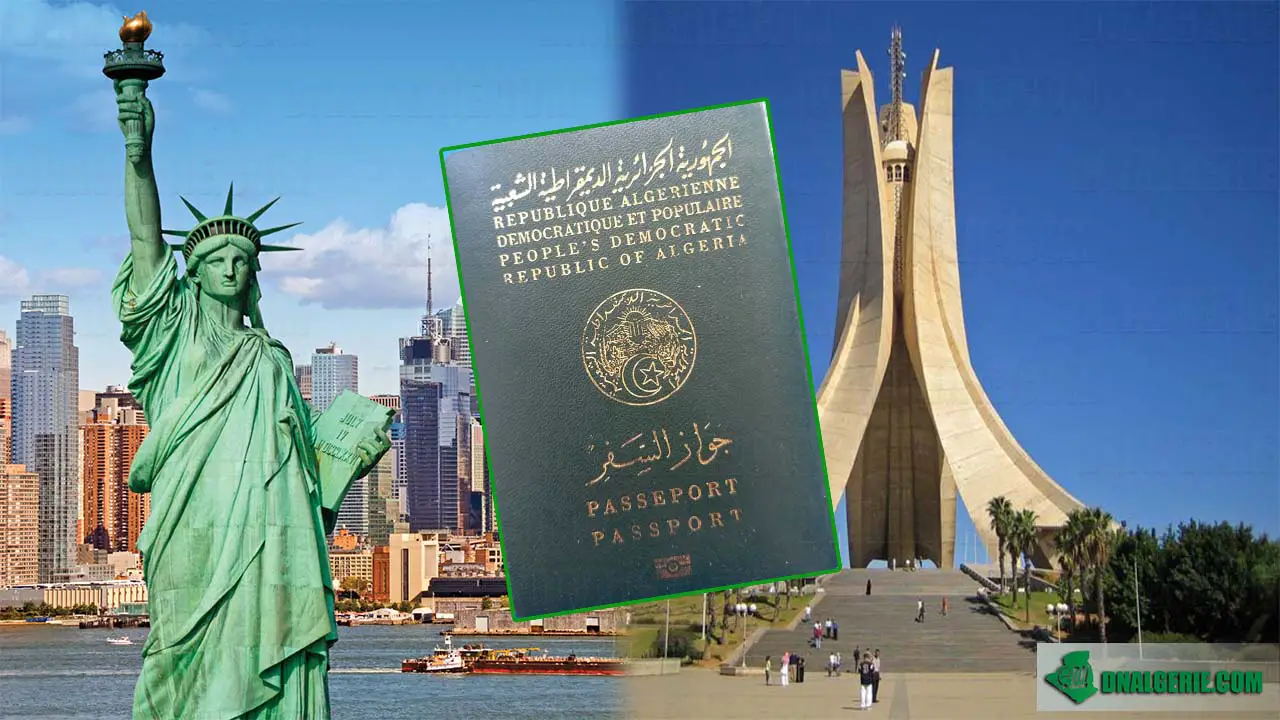L’affaire fait grand bruit depuis que le quotidien Le Figaro l’a rendue publique : un Algérien âgé de 39 ans risque jusqu’à 207 ans de prison aux USA, en cas d’extradition vers le territoire américain. Accusé par les autorités des États-Unis d’une série de fraudes électroniques commises entre 2017 et 2020, l’Algérien, connu sous le nom de Sami D., se retrouve aujourd’hui au cœur d’un bras de fer judiciaire entre Paris et Washington. À la fois complexe et sensible, ce dossier soulève de nombreuses interrogations sur les conséquences pénales possibles pour un Algérien confronté à une procédure d’extradition vers les USA.
Les accusations formulées contre cet Algérien par les États-Unis sont d’une extrême gravité. Il lui est reproché d’avoir orchestré une vaste opération de détournement de noms de domaine sur internet, qu’il aurait ensuite revendus à des prix variant entre 60 000 et deux millions de dollars. Le tout sur une période de trois ans. Selon les éléments rapportés, notamment par Le Figaro, ce stratagème numérique aurait généré des profits colossaux, tout en s’appuyant sur des manœuvres informatiques illicites et une usurpation d’identité. L’Algérien est en effet également accusé d’avoir utilisé l’identité d’un magistrat américain en Virginie, l’État à l’origine du mandat d’arrêt délivré en 2021.
Interpellé à Paris à l’été 2024, alors qu’il résidait auparavant à Dubaï, l’Algérien a d’abord été incarcéré plusieurs mois avant d’être placé sous bracelet électronique. Depuis, les audiences se succèdent devant la chambre de l’instruction. Lors de la dernière, qui s’est tenue mercredi, les magistrats ont rappelé que chaque infraction informatique peut entraîner une peine de 20 ans de prison. Avec plusieurs chefs d’accusation à son actif, l’Algérien encourt au total 200 ans d’incarcération pour les fraudes électroniques, auxquels s’ajoutent deux années supplémentaires pour usurpation aggravée et cinq années pour falsification de signature, portant le total théorique à 207 ans de prison aux USA.
Dans un contexte juridique tendu, les autorités américaines ont néanmoins évoqué des possibilités d’aménagement de peine. En cas de plaidoirie de culpabilité, l’Algérien pourrait bénéficier d’une réduction de peine annuelle de 58 jours, selon les documents communiqués au tribunal. Les USA ont également mentionné la possibilité d’une grâce présidentielle, mais sans garantie formelle. L’avocat de l’Algérien, Me David-Olivier Kaminski, a mis en doute la réalité de ces promesses, en rappelant que son client risquait encore 176 années de prison aux USA même en bénéficiant du maximum de réductions prévues. Il a qualifié ce système de « loto judiciaire américain », mettant en cause l’absence de sécurité juridique comparable aux standards français.
L’Algérien, de son côté, clame son innocence. Il affirme ne pas être impliqué dans cette affaire, assurant qu’il a été lui-même victime d’une usurpation d’identité. Une ligne de défense que son avocat a longuement développée lors de l’audience, tout en demandant le rejet pur et simple de la demande d’extradition formulée par les USA. L’idée que cet Algérien puisse être transféré dans un système judiciaire où il encourt 207 ans de prison soulève des inquiétudes du côté de la défense, surtout dans un contexte où l’éventualité d’une grâce présidentielle, notamment par l’ex-président Donald Trump, semble des plus incertaines.
La justice française, désormais saisie, doit rendre sa décision le 3 septembre. D’ici là, l’Algérien reste sous contrôle judiciaire, dans l’attente d’un verdict qui pourrait sceller son sort. Que la demande d’extradition soit acceptée ou non, cette affaire met en lumière les conséquences extrêmes que peut avoir une accusation de cybercriminalité aux USA, et la complexité des dossiers impliquant un Algérien faisant face à la justice américaine. L’exemple de Sami D. rappelle que les peines encourues dans de telles affaires ne sont pas symboliques : 207 ans de prison restent, même théoriquement, une perspective terrifiante.