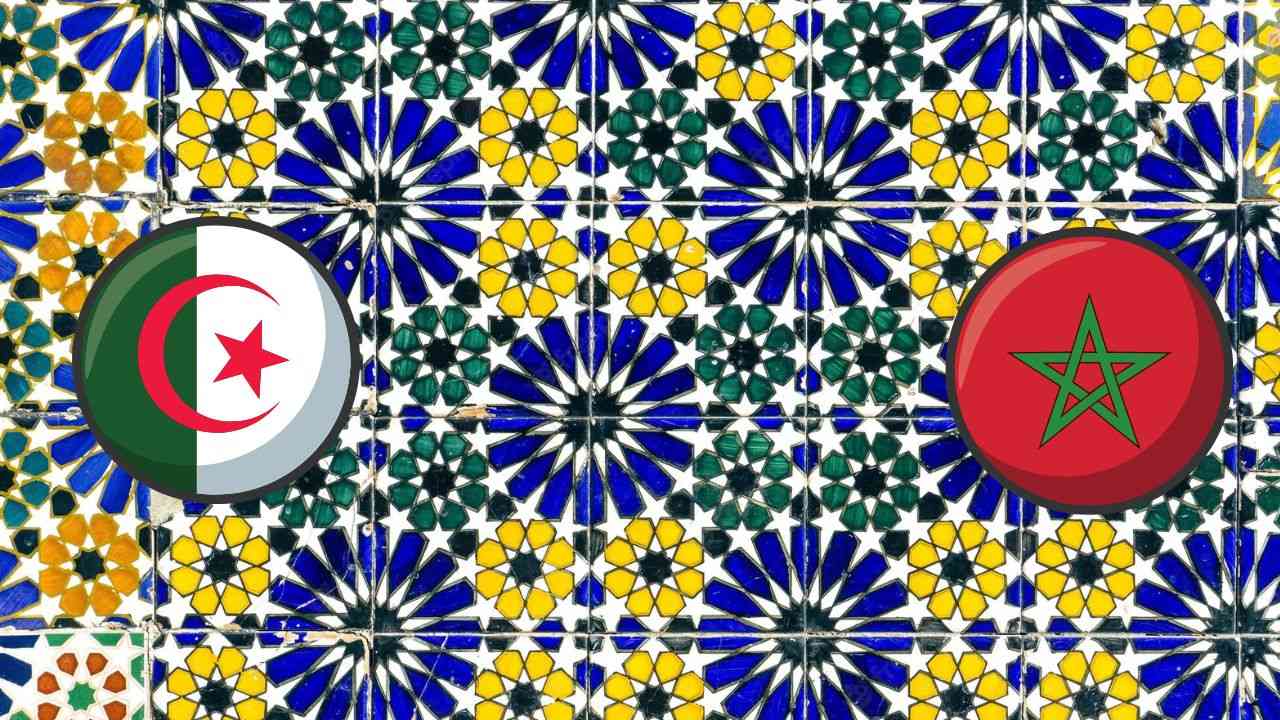Dans un tournant inattendu mais soigneusement orchestré, l’Algérie vient de prendre de court son voisin marocain en déposant un dossier auprès de l’UNESCO pour l’inscription du zellige sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Cette démarche, rendue publique par le ministre algérien de la Culture Zouhir Ballalou, a été annoncée en marge de la Journée arabe du manuscrit arabe, événement célébré récemment à Alger. Le ministre a précisé que deux dossiers ont été officiellement soumis : le premier concerne le zellige, ce célèbre art du revêtement en céramique, et le second est dédié aux habits et bijoux traditionnels kabyles. L’initiative s’inscrit dans une stratégie claire de l’Algérie visant à réaffirmer son ancrage culturel et à reprendre possession d’éléments patrimoniaux souvent attribués, à tort, à d’autres pays.
Depuis des années, le Maroc revendique le zellige comme un héritage exclusivement marocain, l’utilisant abondamment comme outil de promotion touristique et identitaire. Pourtant, les preuves historiques et les traditions architecturales en Algérie racontent une autre histoire. À Tlemcen, Constantine, Alger et dans d’autres villes algériennes, l’art du zellige est pratiqué depuis des siècles. Il orne les mosquées, les palais et les maisons anciennes, témoignant d’une maîtrise artisanale ancestrale et d’une esthétique profondément ancrée dans le territoire algérien. En déposant officiellement ce dossier à l’UNESCO, Alger rompt avec des années de silence et se positionne comme un acteur vigilant dans la préservation de son patrimoine.
Ce geste ne s’arrête pas à une simple réponse diplomatique ou culturelle. Il s’inscrit dans un projet plus vaste, comme l’a précisé le ministre Ballalou. L’Algérie prévoit également le dépôt de douze nouveaux dossiers liés au patrimoine culturel matériel, afin d’actualiser la liste indicative algérienne auprès de l’UNESCO. Cette dynamique est présentée comme un pilier de la diplomatie culturelle nationale. Le ministre a souligné qu’il s’agit là d’une « sécurité culturelle », d’un outil stratégique pour préserver l’identité nationale et intégrer le patrimoine dans la dynamique socioéconomique du pays.
Lors d’un colloque organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, le ministre Ballalou a également levé le voile sur une liste de sites culturels et naturels que l’Algérie souhaite inscrire au patrimoine mondial. Parmi eux figurent des lieux emblématiques comme le parc national du Djurdjura, le parc d’El Kala, la région de Tafdest dans le Hoggar, ainsi que les oasis de Ghoufi et El Kantara. S’ajoutent à cela des sites culturels d’une richesse exceptionnelle tels que Bendroma, Tarara, le système d’irrigation de Ghout à Oued Souf, les mausolées royaux antiques répartis sur plusieurs wilayas, le patrimoine archéologique de Tébessa et les châteaux du Touat-Gourara-Tidikelt.
Ces candidatures multiples démontrent l’importance stratégique que l’Algérie accorde désormais à son patrimoine, non seulement comme vecteur d’identité, mais aussi comme levier de rayonnement international. En misant sur une politique culturelle active, l’État entend défendre chaque pan de son histoire contre les tentatives d’appropriation ou d’effacement.
Le cas du zellige est emblématique. Il illustre la nécessité de revendiquer ce qui appartient au passé commun d’un peuple, surtout lorsque ce passé est menacé par des récits unilatéraux. L’Algérie n’entend plus se contenter de constater le détournement ou la confusion autour de ses expressions culturelles. Elle agit, prend les devants et affirme sa voix dans les instances internationales. Ce positionnement pourrait bien redéfinir les équilibres culturels au Maghreb et forcer une relecture des origines de plusieurs traditions partagées mais trop souvent monopolisées dans le discours.
Alors que le Maroc continue d’affirmer, à tort, que le zellige lui est exclusivement attribué, l’Algérie rappelle, par des actes concrets, que ce patrimoine est également sien, profondément enraciné dans son territoire et son histoire. Le dépôt officiel du dossier à l’UNESCO est bien plus qu’un simple geste administratif : c’est une déclaration de souveraineté culturelle, portée par une volonté ferme de reconnaissance et de justice patrimoniale.
Lire également :
Algériens de France : la Préfecture de Paris fait une annonce réjouissante
« C’est détecté » : le Préfet de Paris met en garde les Algériens
Alerte en Algérie, à cause d’un produit venu de France