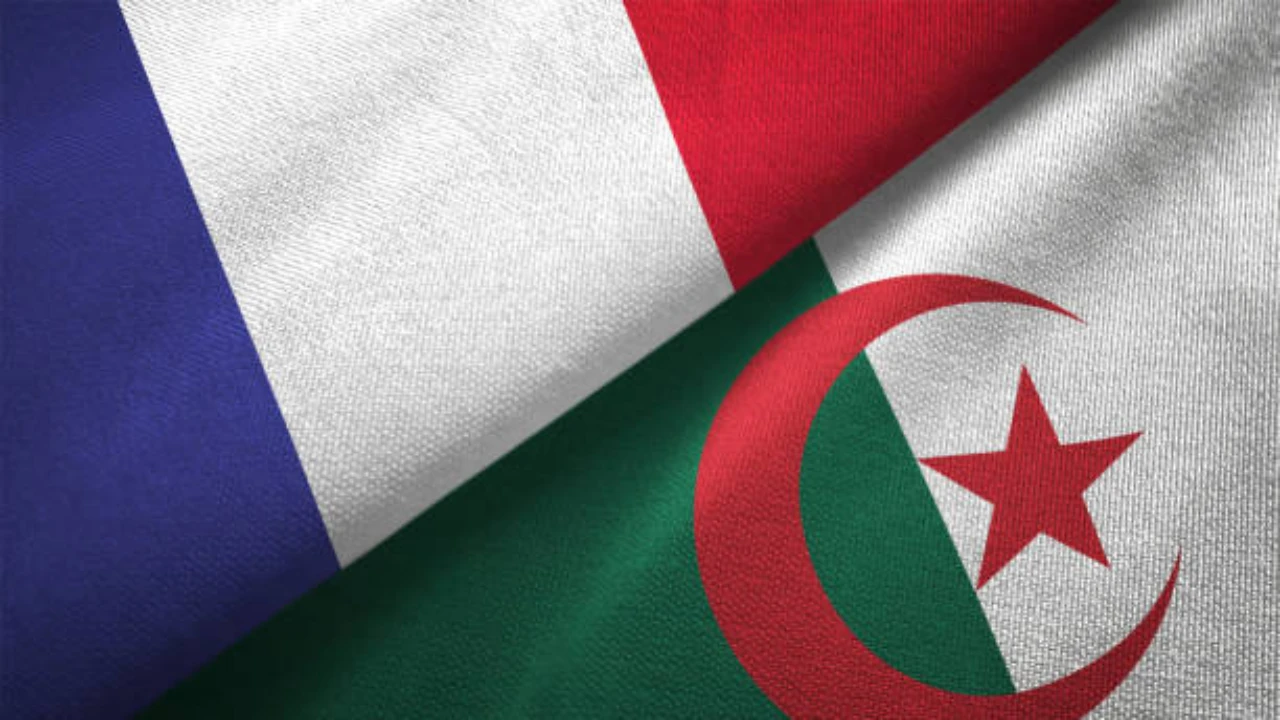L’économie française traverse une période de turbulences qui ne doit rien au hasard. Un rapport parlementaire officiel, rendu public début novembre, confirme que l’Algérie a profondément impacté plusieurs secteurs clés de l’économie française, notamment celui du commerce extérieur et de l’agriculture. Ce document, élaboré par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale française, met en lumière les conséquences économiques directes du refroidissement diplomatique entre Paris et Alger. Cette situation, née de tensions politiques persistantes, a entraîné un recul significatif des exportations françaises vers l’Algérie et fragilisé l’un des piliers historiques des échanges bilatéraux : le blé.
Selon le rapport daté du 5 novembre 2025, l’Algérie, qui fut pendant plusieurs années le premier client de la France pour le blé tendre, n’a plus importé de céréales françaises depuis 2023 et 2024. Ce changement brutal a privé la France d’un débouché majeur représentant en moyenne cinq millions de tonnes de blé par an, soit près de la moitié de ses exportations mondiales dans ce secteur. L’économie française, déjà affectée par une conjoncture mondiale instable, voit ainsi un de ses marchés les plus sûrs disparaître. Pour les parlementaires français, la dégradation diplomatique avec l’Algérie a eu un effet immédiat sur le commerce extérieur, faisant de ce pays un exemple frappant de souveraineté économique assumée.
Le rapport souligne que la perte du marché algérien a contribué à la baisse du surplus commercial agricole français pour l’année 2024. Historiquement, l’Algérie représentait un maillon essentiel pour l’économie française en Afrique du Nord, facilitant la diffusion de produits agricoles et agroalimentaires vers le continent africain. Aujourd’hui, cette relation stratégique semble rompue, laissant la France dans une position inconfortable. L’Algérie, en réorientant ses partenariats vers d’autres fournisseurs internationaux, a utilisé son indépendance économique comme un levier diplomatique. Ce choix, perçu à Paris comme une double perte — économique et symbolique — met en évidence le déplacement des équilibres entre les deux pays.
Lors des discussions à l’Assemblée nationale, le député Maxime Lisnie, représentant de la coalition de gauche France insoumise – Nouvelle Front populaire, a regretté la détérioration des liens franco-algériens. Il a rappelé que la fin des importations de blé par l’Algérie représentait près de 50 % des exportations françaises dans ce secteur, un manque à gagner considérable pour l’économie française. Il a également exhorté le gouvernement à abandonner les politiques jugées hostiles envers l’Algérie, estimant qu’elles aggravent la crise diplomatique. Dans le même temps, il a dénoncé la proposition du Rassemblement national, qui souhaite remettre en cause l’accord bilatéral de 1968 régissant la résidence et la circulation des Algériens en France. Pour lui, cette démarche ne ferait qu’accentuer les tensions et nuire encore davantage aux intérêts économiques français.
À l’opposé, le député Alexandre Allegray-Bello, issu du parti Les Républicains, a exprimé sa préoccupation quant au boycott des produits français par l’Algérie, estimant que la France devait réévaluer ses priorités. Selon lui, puisque l’Algérie ne contribue plus au dynamisme du commerce agricole français, il est légitime pour la France de réexaminer sa politique migratoire et ses accords anciens. Ce discours illustre les divisions profondes au sein du paysage politique français face à une crise économique alimentée par la rupture des liens avec Alger.
Au-delà du cas du blé, ce rapport révèle une fragilité structurelle de l’économie française face à la perte de marchés stratégiques comme celui de l’Algérie. L’impact dépasse les chiffres des exportations agricoles : il remet en question la place de la France dans les échanges internationaux et son influence en Afrique du Nord. En refusant de dépendre des importations françaises, l’Algérie affirme son autonomie et redéfinit ses partenariats commerciaux selon ses propres intérêts. Ce tournant illustre la volonté d’Alger de construire une économie moins dépendante des anciennes puissances coloniales, un signal fort adressé à Paris.
L’économie française, pour sa part, doit désormais composer avec une réalité nouvelle : celle d’un partenaire historique devenu un acteur souverain qui n’hésite pas à faire prévaloir ses choix nationaux sur les anciennes solidarités économiques. Dans ce bras de fer silencieux entre l’Algérie et la France, c’est tout un pan de la politique commerciale française qui se trouve remis en question. Les experts s’accordent à dire que la perte du marché algérien ne se limite pas à une simple chute des exportations agricoles, mais symbolise une fracture durable entre deux économies autrefois étroitement liées. En redéfinissant les règles du jeu, l’Algérie impose désormais à la France un nouveau rapport de force, révélant au passage la vulnérabilité d’une économie française en quête de nouveaux équilibres sur la scène internationale.