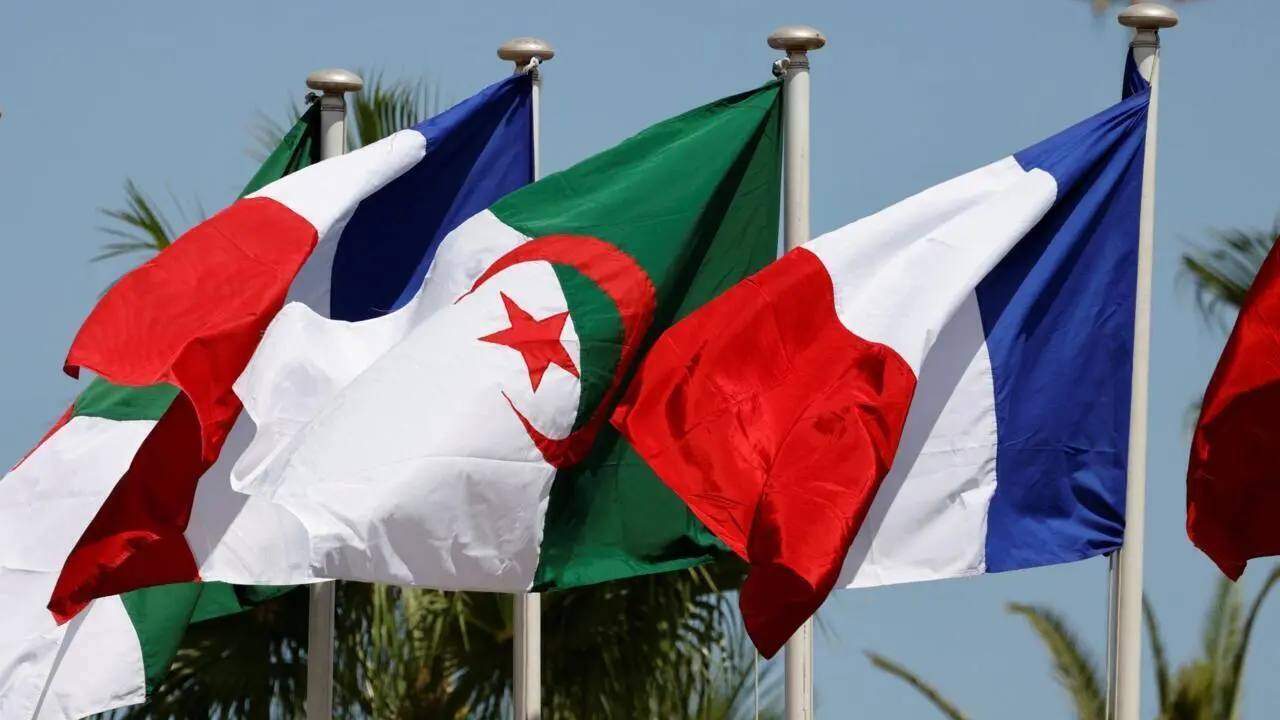L’accord franco-algérien de 1968, signé peu après l’indépendance de l’Algérie, refait surface au cœur d’une tempête politique et médiatique. Ce mercredi matin, le député Renaissance Charles Rodwell, président de la commission d’enquête parlementaire, a présenté un rapport qualifié d’explosif sur les effets économiques et juridiques de cet accord franco-algérien. Selon ses conclusions, cet accord coûterait entre 1,5 et 2 milliards d’euros par an aux finances publiques françaises. Une affirmation qui, en quelques heures, a provoqué une vague de réactions contrastées, tant à l’Assemblée nationale que sur les réseaux sociaux.
Le rapport de 75 pages met en avant ce que le député appelle un « déséquilibre structurel » entre la France et l’Algérie. « L’État est aveugle et désarmé face aux effets réels de l’accord franco-algérien sur nos comptes publics », a-t-il déclaré devant la presse. Il estime que les dispositifs dérogatoires en matière de séjour, d’emploi et de prestations sociales représentent une charge budgétaire importante. Le coût de 2 milliards d’euros inclurait les aides au logement, les allocations familiales, le RSA et l’aide médicale d’État. Pour lui, ce chiffre reste “une estimation prudente” car, selon ses mots, « la France ne dispose pas d’outils statistiques suffisants pour mesurer précisément l’impact de l’accord franco-algérien ».
Mais cette présentation a suscité de vives critiques. La députée écologiste Sabrina Sebaihi, d’origine algérienne, a vivement réagi : « Et ce que rapportent les immigrés algériens, vous ne le mentionnez pas ? Nous avons plus de 15 000 médecins algériens qui permettent à nos hôpitaux français de tenir debout. » Cette réplique illustre l’un des points centraux du débat : la contribution économique et sociale des ressortissants algériens, souvent absente des rapports budgétaires strictement comptables.
Sur le plan diplomatique, cette polémique intervient dans un contexte tendu entre Paris et Alger. En août dernier, Emmanuel Macron avait suspendu l’accord de 2013 sur les visas diplomatiques, à la suite d’un différend lié à la détention de deux otages français en Algérie. Charles Rodwell a reconnu avoir retardé la publication de son rapport de plusieurs mois afin de ne pas nuire aux échanges diplomatiques en cours. Il affirme aujourd’hui vouloir « ouvrir un débat responsable sur un texte devenu obsolète ».
Signé le 27 décembre 1968, l’accord devait initialement encadrer l’immigration de travail entre les deux pays. Mais, au fil des décennies, les interprétations juridiques et politiques en ont fait un régime d’exception. Selon le rapport, seule la France appliquerait désormais pleinement les clauses, tandis qu’Alger n’en respecterait plus certaines, notamment celles relatives à la sécurité sociale de 1980. Ainsi, la France compenserait des pensions et allocations destinées à des retraités algériens sans contrepartie bilatérale, alimentant le coût total évalué à 2 milliards d’euros.
Charles Rodwell estime que cette situation porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité. Les ressortissants algériens bénéficient de droits spécifiques : regroupement familial après 12 mois de résidence, absence de contrôle strict des ressources, régularisation automatique après 10 ans de présence, ou encore un accès facilité au RSA et à l’ASPA. « Un citoyen algérien ne devrait avoir ni moins, ni plus de droits qu’un autre étranger », a-t-il insisté, plaidant pour un alignement sur le droit commun.
Le député défend une approche qu’il dit “juridiquement équilibrée et politiquement responsable”. Pour lui, rompre l’accord franco-algérien ne serait pas un geste hostile envers Alger, mais une “étape nécessaire vers la normalisation diplomatique et la réciprocité”. Cette vision est partagée par plusieurs membres de la majorité présidentielle, dont Gabriel Attal, qui voit dans cette révision un moyen de restaurer une égalité de traitement entre étrangers.
Cependant, ce rapport intervient dans un climat chargé d’enjeux identitaires et économiques. Certains observateurs soulignent qu’il ravive des tensions historiques entre la France et l’Algérie, alors que les deux pays tentaient depuis plusieurs mois de réchauffer leurs relations. D’autres y voient une manœuvre politique visant à replacer la question migratoire au cœur du débat national, à l’approche de nouvelles échéances électorales.
Quoi qu’il en soit, la publication du rapport de Charles Rodwell a ravivé une polémique qui ne faiblit pas. L’accord franco-algérien de 1968, souvent méconnu du grand public, s’impose à nouveau comme un symbole des liens complexes entre Paris et Alger — un texte hérité d’une autre époque, mais dont les conséquences économiques et politiques continuent de peser lourd, à hauteur de 2 milliards d’euros par an selon ses détracteurs.