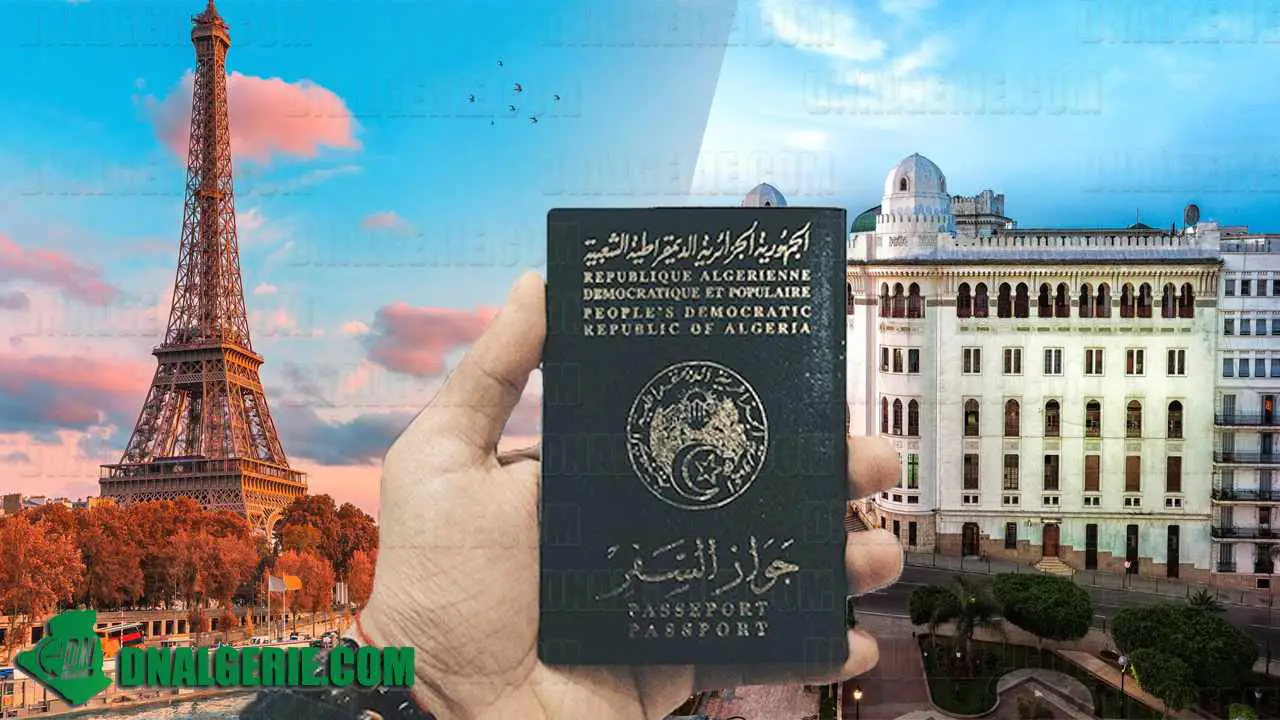« Les Algériens sont le pain de la France », cette déclaration sans détour du romancier Xavier Le Clerc, invité de la matinale de France Inter le mardi 27 mai 2025, n’a pas laissé indifférent. Ce jour-là, face à Léa Salamé, l’écrivain ne cherche ni le clash ni le consensus artificiel, mais seulement à rappeler ce qu’il considère comme une réalité historique, humaine et intime.
« Ce que je dis dans mon livre, nous (Algériens) sommes assimilés depuis longtemps dans la terre de France. Nous sommes le pain de la France. Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit, ce qui compte c’est reconnaître les racines du mal », affirme-t-il avec calme et détermination. Derrière cette formule forte se déploie un récit sensible, chargé de mémoire et d’émotion, que Xavier Le Clerc a mis en mots dans son dernier ouvrage, Le Pain des Français, publié cette année.
Le titre n’est pas anodin. Dans Le Pain des Français, l’auteur ne traite pas uniquement de la relation historique entre la France et l’Algérie, mais creuse plus profondément dans les silences, les blessures et les espoirs partagés entre les deux peuples. « L’apaisement est la seule voie possible face à la violence », déclare-t-il également, insistant sur une démarche de réconciliation plutôt que d’accusation. Car si les Algériens ont été historiquement considérés comme une main-d’œuvre bon marché dans l’Hexagone, comme des êtres jetables pendant et après la colonisation, Xavier Le Clerc affirme que ces mêmes Algériens sont devenus, de manière symbolique et concrète, le pain quotidien de la France, un élément essentiel de son identité sociale, économique, culturelle.
Issu d’une famille d’origine kabyle, Xavier Le Clerc a déjà abordé la question de la mémoire familiale et coloniale dans ses précédents livres. Dans Un homme sans titre, il racontait la vie de son père, ouvrier immigré venu d’Algérie, confronté à la dureté du travail en usine, aux humiliations ordinaires, à l’invisibilité. L’enfant qu’il était observait cette réalité sans toujours la comprendre, mais en ressentait profondément la violence. À travers cette figure paternelle, il exprimait déjà cette vérité silencieuse : les Algériens ont nourri, par leur sueur et leur douleur, les fondations de la France moderne, tout comme le pain nourrit le corps.
Dans Le Pain des Français, Xavier Le Clerc poursuit cette exploration intime et collective en inventant une figure fictive : Zohra, une petite fille de sept ans décapitée en 1845 par les troupes coloniales françaises. Ce personnage, inspiré d’un crâne numéroté retrouvé dans les sous-sols du Musée de l’Homme à Paris, devient un symbole. L’auteur découvre ce crâne dans une boîte grise, au milieu de milliers d’autres restes humains collectés lors des campagnes coloniales. « Les vestiges humains ne sont pas des ossements, mais ce qu’il nous reste d’humanité », écrit-il avec force. Pour Xavier Le Clerc, cette mémoire des morts, comme celle des vivants, doit être racontée, reconnue, sans volonté de vengeance, mais avec le désir de pacifier les blessures.
L’histoire de Zohra, racontée en miroir avec celle de l’écrivain, devient un acte de mémoire poétique. Il imagine cette enfant traversant l’Algérie de 1845, arrachée à la vie par la violence d’un pouvoir colonial. Ce n’est pas uniquement l’histoire d’une victime, mais celle d’un peuple auquel on refuse un tombeau digne, une reconnaissance pleine. Pour Xavier Le Clerc, les Algériens d’hier, tout comme ceux d’aujourd’hui, ont été et sont encore le pain quotidien d’une nation française qui oublie trop vite d’où viennent ses fondations humaines. Dans ses mots, il répète plusieurs fois cette triple équation : les Algériens sont le pain, et les Français, en déniant cette vérité, oublient une part d’eux-mêmes. « Je ne veux pas cesser de chérir cette gamine, comme je ne veux pas cesser de chérir nos ancêtres morts dans des conditions aussi tragiques et dramatiques. Je ne veux pas cesser de chérir leur mémoire qu’il faut raconter », explique-t-il, sans colère mais avec un chagrin lucide.
Xavier Le Clerc ne cherche pas à enfermer la France dans son passé, ni à figer les Algériens dans une image de victime. Il raconte les faits, les noms, les dates, les lieux. Il réveille les fantômes pour mieux leur offrir un lieu de repos. « La vie ne s’arrête pas aux vivants. Je pense d’ailleurs que les morts sont parfois plus vivants que nous. Les morts nous rappellent à la vie, ce qu’elle a de plus beau », affirme-t-il avec cette douceur mélancolique qui traverse tout son récit. L’écrivain ne dénonce pas les Français, mais les invite à regarder leur histoire en face, aux côtés des Algériens, car sans les Algériens, dit-il, il n’y aurait pas eu cette France d’aujourd’hui, pas plus qu’il n’y aurait de pain sans farine, sans levain, sans chaleur.
Quand il évoque les Algériens, il parle aussi de lui, de son homosexualité qu’il a longtemps vécue dans le silence et la honte. Il s’est échappé à 20 ans de son foyer familial, pour fuir la peur, les insultes, les regards pesants. Cette expérience d’exclusion lui permet aujourd’hui de comprendre intimement ce que signifie être rejeté. Ce rejet, les Algériens l’ont connu, même en étant le pain de la table française. Ce rejet, les Français l’ont parfois pratiqué sans conscience, parfois avec brutalité. Le pain est pourtant partagé. Il est aussi ce lien entre ceux qui arrivent et ceux qui accueillent, entre ceux qui ont été dominés et ceux qui ont hérité de cette domination. Ce lien, l’auteur veut le recoudre avec ses mots.
Dans son livre, il parle d’un pays divisé mais guérissable, d’une mémoire en conflit mais soignable, d’un avenir partagé si les deux rives osent enfin se regarder. Il ne demande pas des excuses, mais une reconnaissance : reconnaître que les Algériens ont contribué à la prospérité des Français, que ce pain partagé ne doit pas être gaspillé dans l’oubli. « Il n’y a personne de vivant aujourd’hui qui soit responsable du passé », dit-il, « et je ne suis pas dans une démarche acrimonieuse. » Ce qu’il souhaite, c’est une mémoire assumée, dépassionnée, mais présente. Un pain rompu, pas brisé. Une mémoire vivante, pas vengeresse.
Le Pain des Français est donc bien plus qu’un livre sur la colonisation ou l’immigration. C’est un cri doux, une main tendue, un regard réciproque. C’est une tentative de réconcilier les Algériens et les Français à travers le pain de la mémoire, le pain du quotidien, le pain de l’histoire partagée. À plusieurs reprises, Xavier Le Clerc revient sur cette formule : « Nous sommes le pain de la France. » Cette phrase, martelée sans provocation, devient une prière laïque, un appel à l’apaisement, une réponse à la violence. Elle dit tout : les Algériens, malgré tout, ont fait et font partie des Français, et il est temps de le reconnaître pleinement, sans honte aucune.