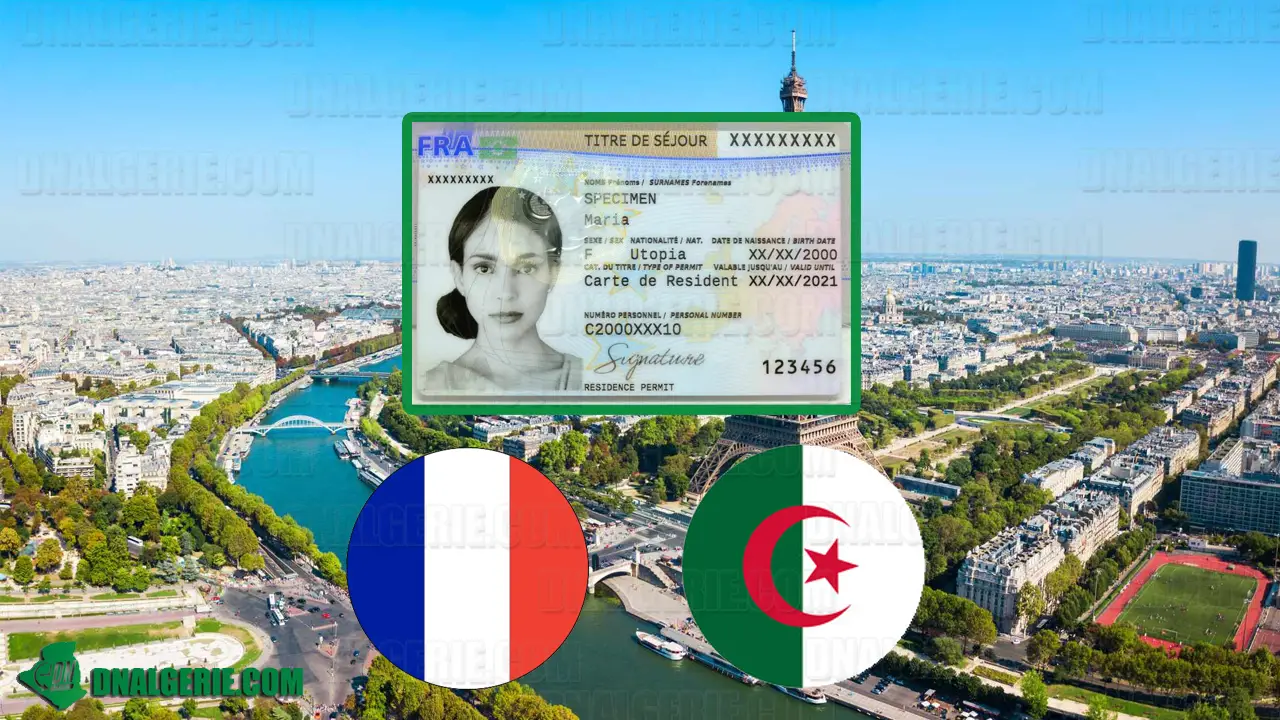Dans un contexte où les délais de traitement des dossiers de titre de séjour suscitent de plus en plus d’inquiétudes parmi les ressortissants étrangers, la décision rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy le 10 juillet 2025 dans l’affaire de Mme PO, une Algérienne née en 1989, établit un rappel juridique d’importance. L’intéressée, arrivée en France en 2020 grâce à un visa de long séjour portant la mention « visiteur », a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour, le dernier ayant expiré le 3 août 2024. C’est dans ce cadre qu’elle a engagé une procédure en référé afin de contester le refus implicite opposé par la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement.
Dans cette affaire, Me Fayçal Megherbi, avocat au barreau de Paris, a transmis la contribution à la rédaction de DNAlgérie, afin de porter à la connaissance du public les détails d’un contentieux révélateur des pratiques actuelles en matière de séjour des étrangers. Selon les documents transmis, la requérante avait introduit, à plusieurs reprises, des demandes de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice ANEF. La première, déposée le 13 mai 2024, a été clôturée au motif qu’elle avait été formulée trop tôt. La deuxième, déposée le 3 juin 2024, a été classée sans suite le 12 juillet suivant, car elle aurait dû être faite sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Ce n’est que le 14 juillet 2024 que Mme PO, ressortissante algérienne, a pu enfin déposer sa troisième demande de renouvellement selon les formes requises. Pourtant, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus implicite, en ne répondant pas à cette dernière demande, ce qui a conduit à la saisine du juge.
Dans sa requête, Mme PO a sollicité la suspension de l’exécution de cette décision, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Selon ses dires, la condition d’urgence était manifeste : elle se retrouvait, depuis l’expiration de son titre de séjour, dans une situation administrative précaire, alors que son époux et ses enfants vivent régulièrement en France. Elle invoquait en outre un ensemble d’irrégularités juridiques, notamment un défaut de motivation, ainsi que la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié.
« Cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale », lit-on dans la contribution de Me Fayçal Megherbi, qui souligne également que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. L’Algérienne concernée par cette procédure faisait également valoir la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, estimant que son cas n’avait pas été évalué à la lumière de sa situation familiale globale. Pour appuyer sa demande, elle insistait sur la présomption d’urgence qui entoure les décisions de refus de renouvellement de titres de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dans son mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, s’était opposé à cette interprétation, affirmant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Il faisait valoir que l’Algérienne avait elle-même contribué à créer cette situation d’urgence, notamment en déposant sa demande de titre de séjour en dehors des délais réglementaires, tels que fixés à l’article R. 431-5 du CESEDA. Toutefois, comme le rappelle l’ordonnance, cette thèse ne résiste pas à l’examen des faits. En effet, la succession des démarches de la requérante, les clôtures prématurées de ses premières demandes, ainsi que le manque d’informations sur les bonnes procédures à suivre, démontrent sa diligence. L’Algérienne n’a pas manqué de réactivité, en déposant sa dernière demande seulement deux jours après la clôture de la précédente.
Dans ce contexte, le juge des référés a estimé que l’urgence était bien caractérisée. En outre, il a relevé que les arguments juridiques soulevés par la requérante, notamment ceux relatifs à la violation de droits fondamentaux, étaient « de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Ainsi, les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative – l’urgence et le doute sérieux – étant réunies, la suspension de la décision implicite de refus a été prononcée.
Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme PO. Par ailleurs, il lui est enjoint de délivrer, sous trois jours, « tout document administratif attestant de la régularité de son séjour », valable jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue sur le fond. L’ordonnance du 10 juillet 2025, référencée sous le numéro 2510856, offre ainsi à cette Algérienne une respiration juridique, en suspendant les effets immédiats d’un refus qui aurait pu durablement bouleverser sa vie familiale.
Le cas de cette Algérienne met en lumière une problématique plus large, partagée par de nombreux ressortissants étrangers en France, confrontés à des plateformes numériques souvent déroutantes et à une communication administrative déficiente. Ici, la succession des dépôts – ANEF, démarches-simplifiées – et les fermetures inexpliquées de dossiers montrent que même les démarches les plus rigoureuses peuvent se heurter à l’opacité des circuits institutionnels.
Au cœur de cette affaire, le titre de séjour devient non seulement un droit administratif, mais aussi un enjeu de stabilité familiale, d’intégration, et d’accès aux droits fondamentaux. L’Algérienne, en l’occurrence, ne contestait pas un refus en soi, mais la manière dont ce refus s’est formé, sans explication claire, et sans considération suffisante de ses attaches en France. Me Fayçal Megherbi, dans sa contribution transmise à la rédaction de DNAlgérie, souligne que cette décision rappelle « les règles du renouvellement du titre de séjour » et réaffirme le rôle essentiel du juge des référés comme gardien des droits dans les situations d’urgence.